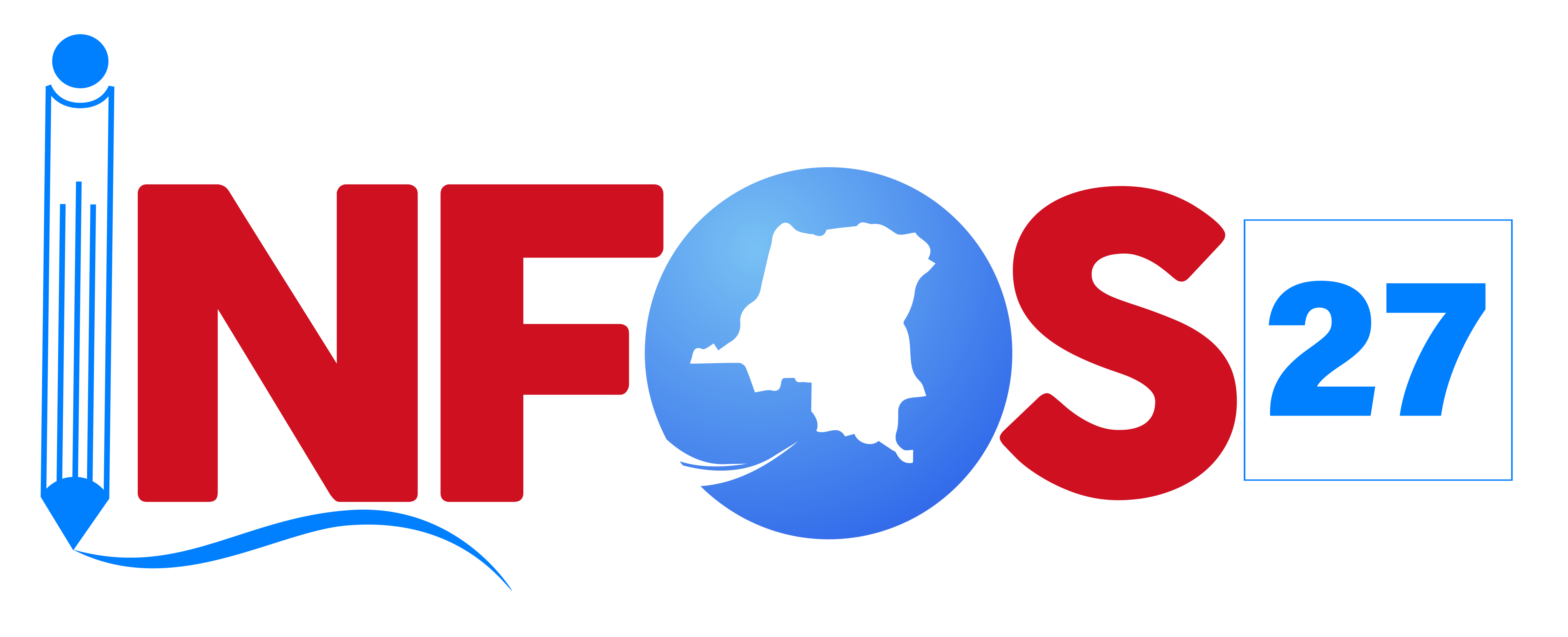En choisissant de garantir la scolarisation des filles enceintes, le gouvernement congolais fait le pari courageux d’une éducation inclusive fondée sur les droits, la dignité et la justice sociale. Face aux critiques virulentes de certains milieux conservateurs, Patrick Muyaya a opposé une parole lucide et ferme : non, la République ne cède pas à la permissivité, elle refuse simplement de punir deux fois une enfant déjà vulnérabilisée par une grossesse souvent subie. À ceux qui brandissent la morale pour justifier l’exclusion, le ministre rappelle que l’État a le devoir de protéger, d’éduquer et d’émanciper, y compris — et surtout — quand il s’agit de ses filles les plus fragiles. Les amalgames idéologiques et les rigidités doctrinales ne peuvent prévaloir sur les engagements internationaux de la RDC, ni sur le droit fondamental à l’éducation. L’histoire jugera sévèrement ceux qui, au nom d’une éthique sélective, choisissent d’abandonner les victimes au lieu de les accompagner. Le gouvernement, lui, trace une ligne claire : celle de la responsabilité, de la modernité et de la résilience.
Au cœur d’une vive controverse déclenchée par une circulaire du ministère de l’Éducation nationale garantissant le maintien à l’école des filles enceintes, le gouvernement a élevé la voix. Jeudi 17 juillet, lors du Briefing presse consacré au bilan de l’ANSER, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a dénoncé les amalgames et les lectures idéologiques autour d’une mesure qu’il qualifie de progressiste et de conforme aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo.
« L’État n’encourage pas la grossesse précoce, mais il protège la fille mineure, souvent victime, contre une double peine : l’exclusion sociale et l’exclusion scolaire », a-t-il tranché.
Faux procès, selon le ministre, que d’assimiler cette avancée en matière d’éducation inclusive à une prétendue promotion de la dépravation. « C’est un sujet qui réveille les traditions, les perceptions, les idéologies. Il faut le traiter sans passions », a martelé Patrick Muyaya, visiblement agacé par les réactions virulentes de certains milieux conservateurs, dont l’Église catholique.
Une circulaire au nom de l’inclusion
Publiée le 14 juillet par le ministère de l’Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, la circulaire rappelle que l’école est un droit pour tous les enfants, y compris les filles enceintes. Elle s’inscrit dans la logique d’une éducation inclusive, en rupture avec des décennies d’exclusion systématique des jeunes filles tombées enceintes. Jusque-là, une grossesse suffisait pour les renvoyer, souvent définitivement, des bancs de l’école.
Le gouvernement justifie cette décision par les principes d’égalité des chances, de justice sociale et de respect des droits fondamentaux de l’enfant, contenus notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la RDC.
L’Église catholique oppose son veto
Mais cette initiative saluée par plusieurs organisations de défense des droits des femmes et des enfants heurte de plein fouet la doctrine morale de l’Église catholique, qui gère un large réseau d’écoles conventionnées en RDC. Dans un communiqué publié le 16 juillet, la Commission épiscopale pour l’éducation chrétienne et la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques ont fait savoir qu’elles ne se sentaient pas concernées par cette circulaire. Leur position : la moralité et la discipline doivent primer. L’article 5 de leur Convention, s’appuyant sur l’Accord spécifique sur l’éducation, met en avant une exigence éthique incompatible, selon elles, avec l’accueil de filles enceintes dans leurs établissements.
« Cette disposition (…) ne peut point opérer dans les Écoles conventionnées catholiques », lit-on dans leur déclaration, qui invite les jeunes filles concernées à s’orienter vers d’autres établissements.
Réponse ferme du gouvernement
À ceux qui dénoncent une prétendue permissivité du gouvernement, Patrick Muyaya oppose la réalité juridique et humaine : « On ne peut pas punir doublement une fille mineure. Entre-temps, qu’est-ce qu’on fait de son bourreau ? Parce que peut-être, la fille est victime. »
Le message est clair : la République ne peut pas renoncer à ses obligations au nom d’un rigorisme qui, sous couvert de morale, relègue des mineures déjà vulnérabilisées à une marginalisation encore plus grande. « Il y a les droits garantis par la loi, et les engagements internationaux que notre pays a pris pour protéger l’enfant », a-t-il insisté.
Une ligne de fracture idéologique
Derrière ce débat se dessine une fracture profonde entre deux visions de la société congolaise : d’un côté, une République laïque résolue à étendre les droits éducatifs à toutes les filles, même en situation de grossesse précoce ; de l’autre, une institution religieuse influente, attachée à une certaine conception de la discipline.
La position gouvernementale s’inscrit dans une tendance continentale plus large, plusieurs pays africains ayant revu leur législation pour interdire l’exclusion scolaire des filles enceintes. Mais en RDC, où l’influence des Églises sur le système éducatif reste prégnante, l’enjeu est double : faire avancer les droits tout en préservant le partenariat historique entre État et confessions religieuses.
Une décision qui engage l’avenir
Alors que les jeunes filles congolaises restent parmi les premières victimes des violences sexuelles, des mariages précoces et de la déscolarisation, le gouvernement affirme qu’il ne reculera pas. La protection de l’enfance ne peut être subordonnée à des considérations morales unilatérales. À l’heure de l’agenda 2063 de l’Union africaine et de l’ambition affichée de scolariser massivement les filles, la RDC se veut du côté du progrès. Et pour Patrick Muyaya, les résistances actuelles n’auront pas raison de cette volonté politique : « L’histoire finira par donner raison à ceux qui ont choisi l’humain. »
Infos27