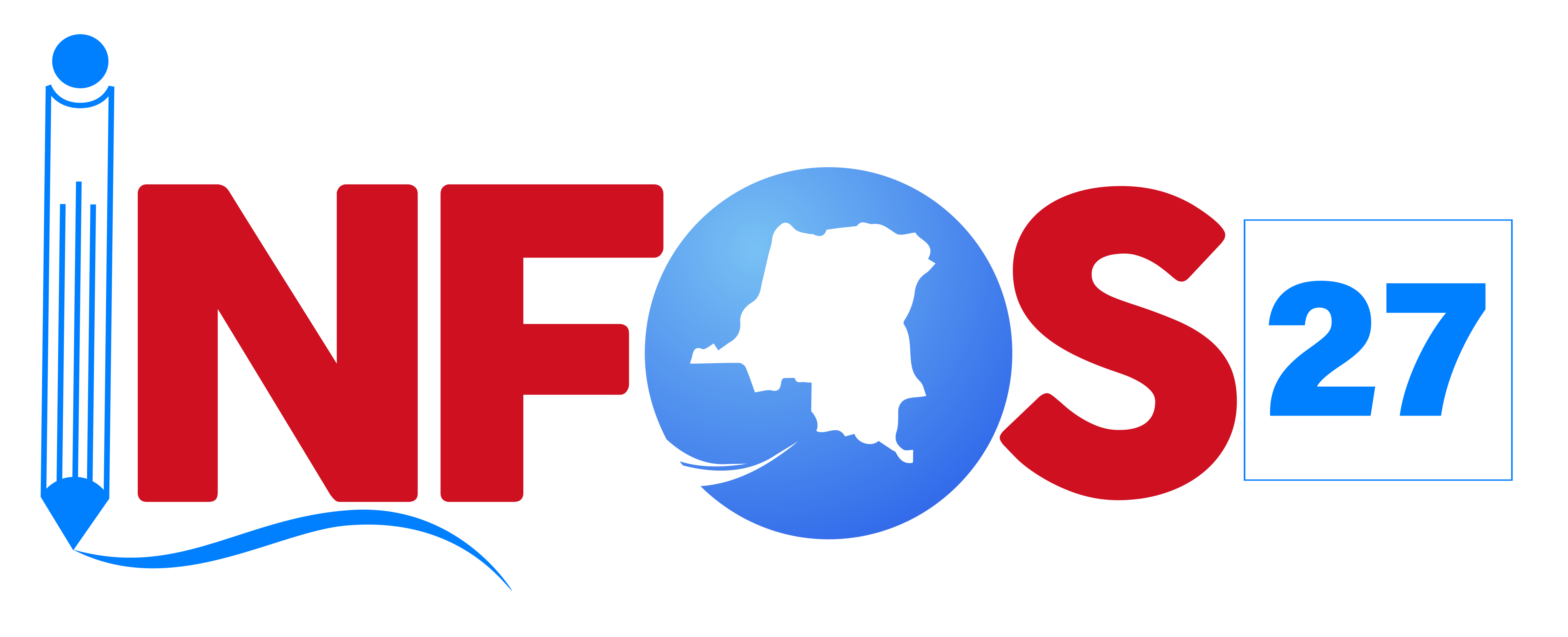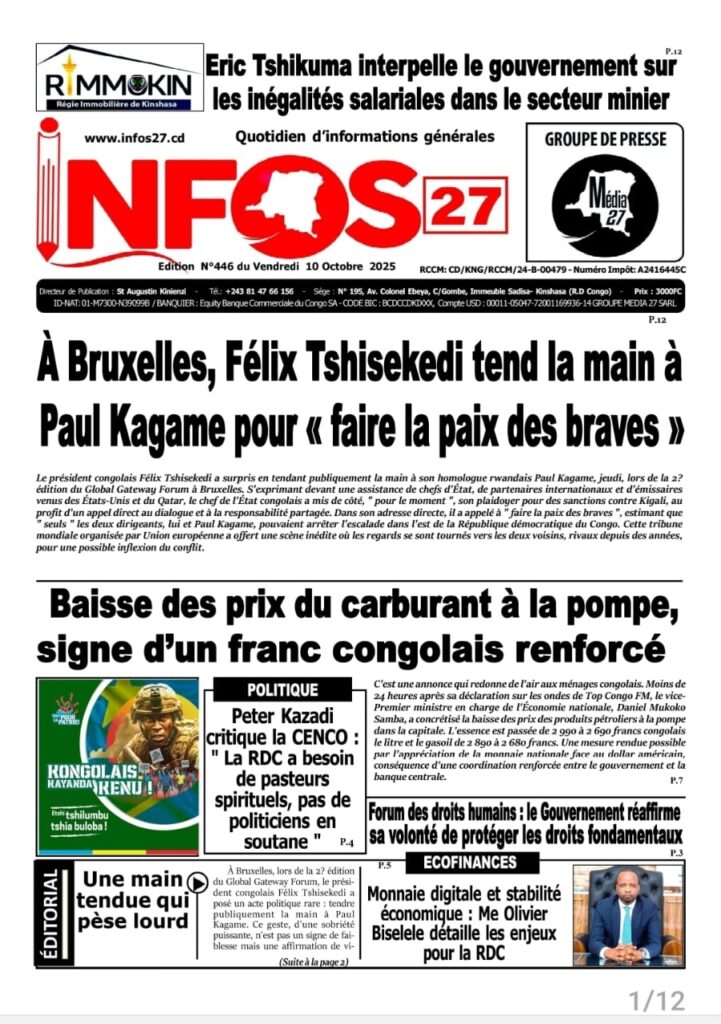La Conférence de Paris sur la région des Grands Lacs a offert au monde l’image d’une solidarité retrouvée. Quinze puissances, des institutions internationales et des partenaires régionaux ont promis 1,5 milliard d’euros pour atténuer la crise humanitaire qui ravage l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Mais derrière les chiffres, derrière les déclarations, demeure une vérité que nul ne peut éluder : aucun financement, aussi généreux soit-il, ne remplacera la paix tant que des forces étrangères continueront d’occuper le territoire congolais.
Car c’est bien là que se joue l’avenir du pays — et au-delà, celui de toute la région des Grands Lacs. Depuis plus de deux décennies, le Nord-Kivu et l’Ituri sont prisonniers d’un cycle de violence entretenu par des groupes armés soutenus, selon des preuves désormais documentées, depuis l’autre côté de la frontière. Cette réalité, que la diplomatie internationale a trop souvent choisie d’enrober de prudence, a été clairement énoncée à Paris : le M23-AFC, appuyé par le Rwanda, reste au cœur du désastre humanitaire congolais. L’aveu, porté à haute voix, engage désormais les États qui se disent amis de la paix.
La conférence du Quai d’Orsay, coprésidée par la France et le Togo, a permis de replacer la RDC au centre du débat international. En annonçant l’ouverture de l’aéroport de Goma aux vols humanitaires, Emmanuel Macron a voulu manifester une solidarité concrète. Mais cette initiative, aussi symbolique soit-elle, ne saurait masquer la cause structurelle du drame : une portion du territoire congolais demeure sous occupation armée, en violation du droit international. Tant que cette situation perdurera, l’aide humanitaire restera un pansement sur une plaie ouverte.
Ce que rappelle avec force le discours de Paris, c’est que la paix ne se décrète pas : elle se construit sur la souveraineté et la justice. La fin de l’occupation n’est pas une revendication politique, mais une exigence morale et juridique. Les partenaires de la RDC, s’ils veulent que leur soutien ait un sens, doivent cesser de considérer le Congo comme un théâtre périphérique de crises africaines. Ce qui s’y joue est une bataille pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, pour l’intégrité des frontières et pour la stabilité du continent.
Dans l’esprit de la Résolution 2773 du Conseil de sécurité, l’heure n’est plus aux demi-mesures ni aux doubles langages. Aucune paix durable ne naîtra du compromis avec l’illégalité. L’histoire a montré que céder à l’impunité, c’est condamner à la répétition des drames. Au contraire, le courage politique — celui d’appeler les choses par leur nom et d’agir en conséquence — pourrait enfin ouvrir la voie à une stabilisation véritable.
La promesse de 1,5 milliard d’euros est un signal fort. Mais la promesse la plus attendue reste celle de la justice : celle qui mettra fin à l’occupation, rendra aux Congolais la pleine maîtrise de leur destin et fera taire les armes dans les collines du Kivu. Sans cette condition, il n’y aura ni paix, ni dignité, ni reconstruction possible dans l’Est de la RDC.
Pitshou Mulumba