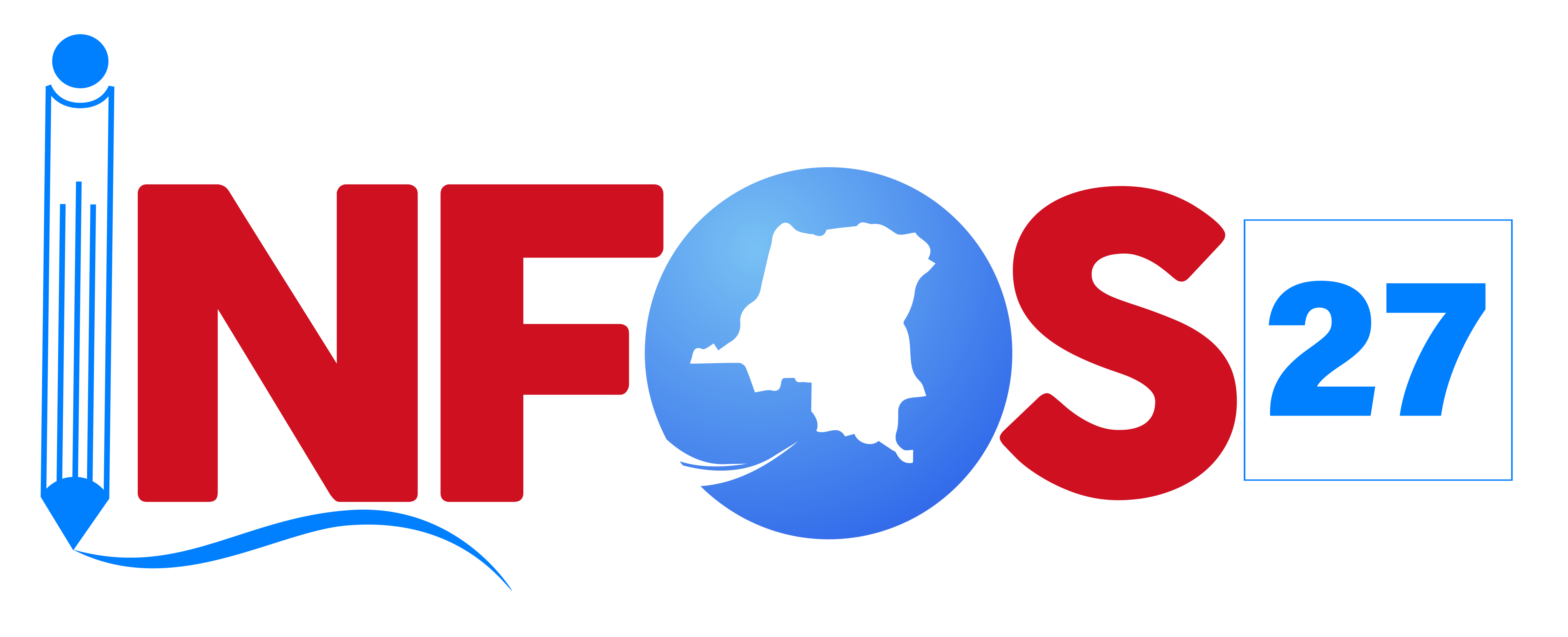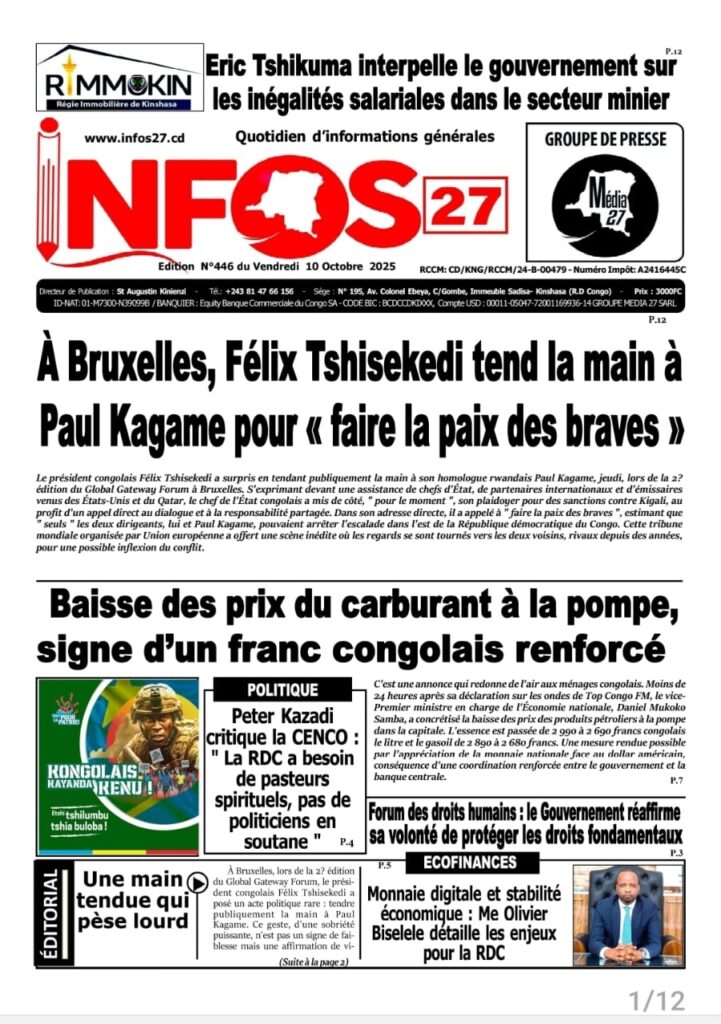Les élections présidentielles au Cameroun et en Côte d’Ivoire, ces derniers jours, ont reconduit les présidents Paul Biya et Alassane Ouattara. Ils ont respectivement été réélus, sans grande surprise, pour un huitième septennat à 92 ans, et un quatrième mandat à 83 ans, toute opposition démocratique ayant été empêchée. La question démocratique reste posée en Afrique, où les pays qui pratiquent l’alternance sont encore minoritaires. Un observateur averti de la vie politique africaine peut, ici, s’interroger sur ces deux élections présidentielles qui se sont déroulées dans deux pays importants d’Afrique francophone, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, et pas seulement sur l’âge du capitaine. Elles sont révélatrices de la difficulté de nombreux pays africains à produire des alternances apaisées, à renouveler les élites quand ceux qui sont en place n’en partent plus.
En 1980, le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, avait fait sensation : il était le premier président sur le continent à avoir choisi de quitter volontairement le pouvoir, sans pression de la rue ou de l’armée. Ses homologues étaient furieux, il donnait le mauvais exemple. Senghor avait gouverné 20 ans, après l’accession du Sénégal à l’indépendance, et avait jugé plus sage de passer la main à la génération suivante.
Hommes providentiels irremplaçables
Force est de reconnaître que dans les deux élections, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, les jeux étaient faits d’avance, la fraude électorale étant érigée en système.
Au Cameroun, le principal candidat opposé à Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary, a proclamé sa victoire, affirmant avoir obtenu 54,8% des suffrages contre 31,3% pour Paul Biya, selon son propre décompte. Mais c’est ce dernier qui a été déclaré vainqueur, avec 53,66%, par la cour suprême acquise au pouvoir. Son adversaire, Issa Tchiroma Bakary, n’est décrété que de 35,19% par l’institution, après que le principal opposant, Maurice Kamto, ait été interdit de se présenter.
Des incidents ont éclaté pour contester ces résultats. Avant même l’annonce des résultats officiels, la police et l’armée ont commencé à réprimer brutalement les mobilisations populaires contre ce énième hold-up électoral, notamment à Douala et Garoua. Des chars ont été déployés et on a compté plusieurs morts en plus de nombreuses arrestations. Ceci prouve que Paul Biya est indéboulonnable, même s’il passe une bonne partie de l’année en cure en Suisse, et que le pays vit au rythme des rumeurs sur sa santé.
En Côte d’Ivoire, pays qui a déjà connu par le passé une guerre civile à la suite d’élections contestées de 2010, les principaux opposants ont été empêchés de se présenter : l’ancien président, Laurent Gbagbo, et l’homme d’affaires, Tidjane Thiam. Sans surprise, le président sortant, Alassane Ouattara, a été réélu pour un quatrième mandat, avec 89, 77% des voix. Un score à la soviétique. Selon la Commission électorale indépendante (CEI), il devance très largement ses adversaires : Simone Ehivet Gbagbo du Mouvement des générations capables (2,4%), Jean Louis Billon du Congrès démocratique (3,09%), l’indépendant Ahoua Don Mello (1,97%), et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix (1,15%).
Deux jours après la proclamation des résultats, les deux principaux partis d’opposition, qui n’ont pas participé au scrutin, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI ) de l’ancien président, Laurent Gbagbo, qui a dénoncé ce qu’il qualifie de « braquage électoral », et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire -Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) de Tidjane Thiam, continuent de rejeter le déroulement de cette présidentielle. Plusieurs de leurs cadres avaient reçu des convocations policières, avant qu’elles ne soient suspendues. Ils appellent à une grande manifestation à Abidjan, le 8 novembre prochain. Ne sera-t-elle pas, sous forme d’injonction, interdite ? Comme on dit, le pouvoir rend fou.
Des réélections qui ne convainquent personne, pas plus que les justifications des intéressés pour s’accrocher au pouvoir, hommes providentiels irremplaçables.
« Toujours le même président »
Il y’a eu ces derniers mois, dans plusieurs pays, un vent de révolte de la Génération Z, une population née après 1995(entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000).
Des gouvernements sont tombés au Népal ou à Madagascar, malgré le caractère spontané et peu structuré de ces mouvements. Et, à ce jour, c’est la Tanzanie qui sombre dans le chaos post-électoral.
Ce n’est pas tant le fait que ces dirigeants aient 92 ou 83 ans, comme Paul Biya ou Alassane Ouattara, qui pose problème. C’est l’immobilisme politique généré par une telle longévité au pouvoir. Lorsque l’alternance n’est pas possible, elle passe par d’autres voies, la rue ou le coup d’état militaire, ou les deux comme à Madagascar récemment.
L’Afrique n’est pas condamnée à cette impasse. Depuis une quinzaine d’années, une vague de contestation, alimentée par une jeunesse de plus en plus instruite et connectée, est venue remettre en cause ces logiques anciennes. Des pays comme le Ghana, le Cap-Vert, le Sénégal ou encore la Zambie ont montré que le changement démocratique est possible sans heurts, sans effusion de sang. Ces alternances réussies ont prouvé qu’il n’est pas nécessaire de faire couler l’encre ou le sang pour tourner la page d’un régime.
La question démocratique reste posée en Afrique, non pas par mimétisme d’un Occident qui n’a pas de leçon à donner, mais pour répondre aux aspirations d’une population jeune et frustrée de voir, comme le chantait autrefois Michel Delpech, « toujours le même président ».
Savoir partir
C’est exactement ce qu’attendent les nouvelles générations : des preuves de rupture avec les pratiques anciennes de l’exercice du pouvoir en Afrique ; des exemples réels des dirigeants capables de se retirer sans créer des chaos ; des leaders qui ne confondent pas pouvoir et possession ; des hommes et des femmes d’État qui pensent à l’après sans chercher à figer le présent.
En cela, la déclaration du président de la République du Benin, Patrice Talon, face à la jeunesse, lundi 28 juillet 2025, au palais de la Marina à Cotonou, « Je ne serai pas candidat à l’élection présidentielle de 2026 », peut créer un précédent. Cette annonce rappelle qu’un dirigeant peut être fort sans être éternel, qu’il peut être respecté sans rester au sommet. Et surtout qu’il peut faire confiance à son peuple, à ses institutions et à l’avenir. La question qui se pose dès lors est celle-ci : est-ce qu’on dirige pour soi ou pour son peuple ? Car, le vrai pouvoir ne se mesure pas à la durée qu’on passe au sommet, mais à ce qu’on laisse derrière soi.
L’Afrique a besoin d’hommes d’État qui savent partir sans se faire supplier, qui laissent derrière eux des institutions fortes plutôt qu’un vide à combler. Bien sûr, ce que Talon tente de faire au Benin n’est peut-être pas parfait, mais c’est courageux. Et c’est bien ce courage que demandent les peuples sur le continent. Ils rêvent d’une Afrique moderne, audacieuse et capable de croire en elle-même. Même après le départ d’un dirigeant charismatique.
Robert Kongo, correspondant en France