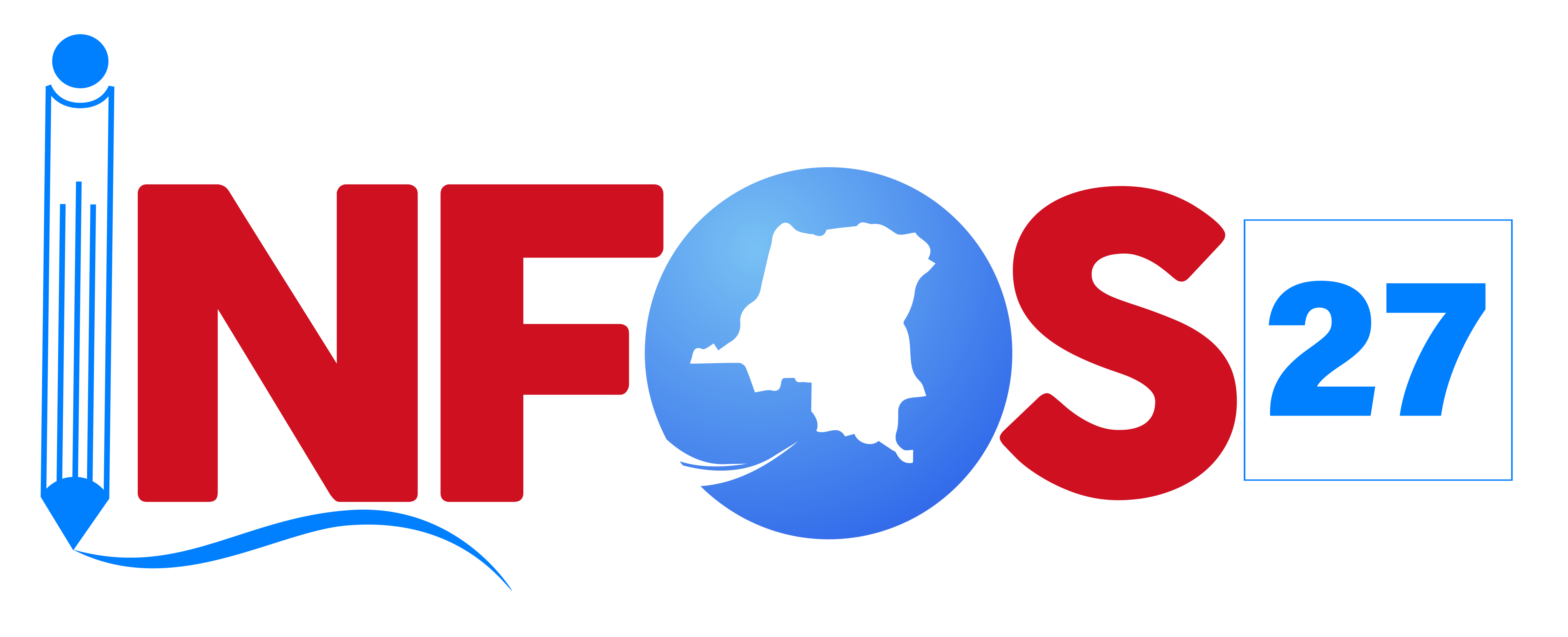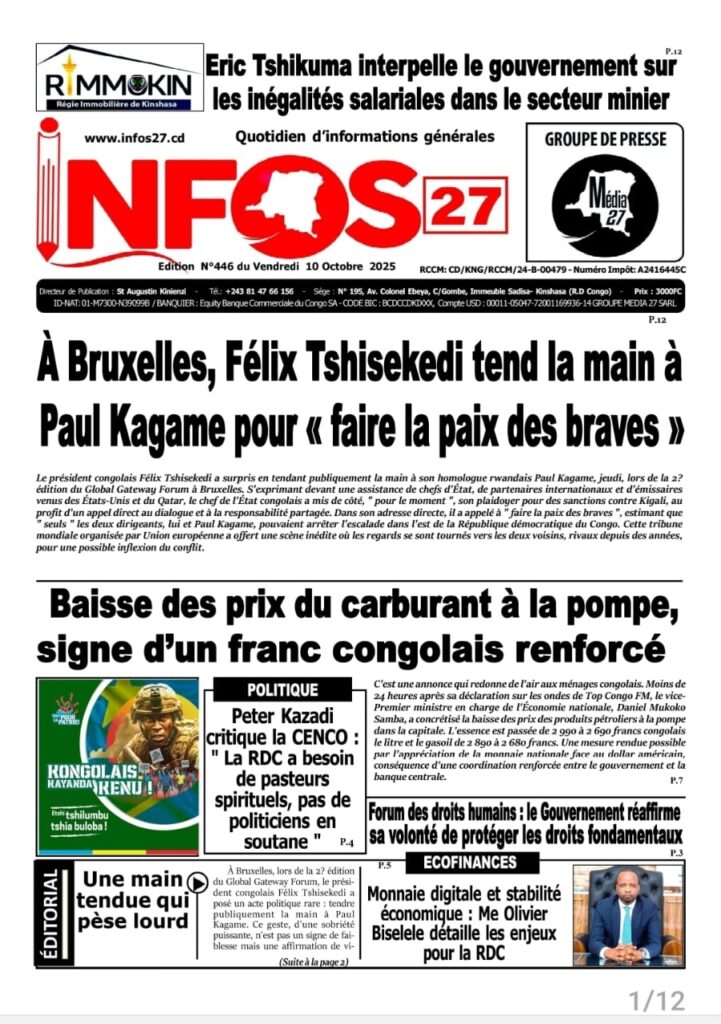Cent ans après la naissance de Patrice Lumumba, la vérité d’un discours traverse le siècle. Dans une tribune publiée ce 20 juillet sur son compte X, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, relit point par point l’allocution historique prononcée par le père de l’indépendance le 30 juin 1960. À l’appui de douze enseignements limpides, il expose la brûlante actualité d’un texte que l’histoire n’a pas refroidi : dénonciation du colonialisme, plaidoyer pour la dignité, alerte contre le tribalisme, vision panafricaine, exigence de justice et de souveraineté… Julien Paluku brosse, avec une lucidité critique, un parallèle entre le rêve lumumbiste et les impasses contemporaines du Congo. Une lecture sans concessions, mais habitée d’un espoir assumé : celui d’une République qui, aux côtés du président Tshisekedi, commence enfin à donner chair à la prophétie d’un homme mort trop tôt.
Sous le titre évocateur « Haro sur le baudet ! », Julien Paluku fait une relecture politique, morale et stratégique du discours de Patrice Emery Lumumba, prononcé il y a 65 ans jour pour jour. Une parole que l’histoire avait jugée dérangeante, mais que les événements valident désormais avec une clarté implacable. Le ministre en retient douze points, autant de leçons de souveraineté, de justice et de lucidité sur l’histoire congolaise.

1. La condamnation d’un “humiliant esclavage”
Premier point saillant : la dénonciation par Lumumba du colonialisme, qu’il qualifia sans détour d’ »humiliant esclavage ». Julien Paluku rappelle que ce passage évoquait les souffrances et les spoliations subies par les Congolais, à qui les richesses du pays n’ont jamais profité. Un rappel qui, en creux, interroge les continuités de cette dépossession dans le présent.
2. Affirmation de la dignité et de la souveraineté
Lumumba, souligne Paluku, croyait en la capacité du peuple congolais à bâtir une nation souveraine, pour peu qu’on lui rende sa liberté de travailler, de décider et de construire. C’est cette dignité, trop souvent piétinée depuis, que le ministre place au centre de l’agenda politique contemporain.
3. Unité nationale, paix sans fusils
Le ministre relève avec force ce que le discours du 30 juin portait de révolutionnaire : un rêve d’unité au-delà des clivages tribaux, une paix fondée non sur les armes mais sur l’entente. « La paix ne viendra pas des fusils et des baïonnettes », disait Lumumba. Julien Paluku y voit un appel intact à rejeter la logique des guerres et des divisions.
4. Un panafricanisme visionnaire
Patrice Lumumba croyait à la solidarité continentale comme seule réponse au colonialisme et à l’impérialisme. Le ministre y voit une boussole encore valide pour résister aux ingérences contemporaines. Le rêve d’une Afrique debout, unie, libre.
5. Coopérer, oui — mais en égaux
Autre leçon, selon Julien Paluku : Lumumba n’était pas hostile à la coopération internationale, mais exigeait qu’elle soit fondée sur le respect mutuel, loin de toute logique de domination. Une lecture qui prend un relief particulier à l’heure des nouvelles formes de dépendance.
6. Un discours d’une clairvoyance sidérante
Pour le ministre, il faut entendre dans les mots de Lumumba la voix d’un visionnaire. Ce qu’il pressentait s’est réalisé. Loin d’être un texte d’époque, le discours du 30 juin apparaît comme un texte prophétique.
7. La continuité des humiliations
Julien Paluku n’édulcore rien : ce que dénonçait Lumumba n’a pas cessé. Les sévices, l’exploitation et les humiliations ont persisté, parfois sous d’autres formes, avec la complicité d’élites locales jugées pourtant plus instruites.
8. Une élite politique instrumentalisée
Le ministre dénonce une classe politique souvent incapable de relire ou d’assumer l’héritage de Lumumba, trop souvent soumise à des influences étrangères, visibles ou invisibles. C’est un réquisitoire contre une mémoire négligée.
9. Le fléau des sociétés-écrans
Dans la lignée des dénonciations lumumbistes, Julien Paluku pointe le rôle des sociétés-écrans dans le pillage économique du pays. Une spoliation moderne, mais non moins brutale, perpétuée avec la bénédiction de certaines complicités locales.
10. Une richesse sans reflet budgétaire
Comment un pays estimé à 24 000 milliards de dollars de potentiel n’a-t-il pas pu, pendant plus de six décennies, voter un budget supérieur à 10 milliards de dollars ? La question du ministre, cinglante, met en lumière un scandale silencieux.
11. Un espoir budgétaire, enfin
Aujourd’hui, souligne Julien Paluku, un seuil symbolique a été franchi : la barre des 10 milliards de dollars de ressources propres est dépassée. Certes, cela reste modeste au regard du potentiel, mais c’est un premier jalon sur le chemin de l’indépendance économique.
12. Une fidélité au rêve lumumbiste
Enfin, le ministre se veut porteur d’espoir. Aux côtés du président Félix Tshisekedi, il dit participer à la concrétisation d’un rêve trop longtemps trahi : celui d’un Congo debout, fort, diversifié économiquement, connecté au monde, maître de son destin. Un rêve qu’il oppose frontalement aux guerres, aux manipulations, aux prédateurs internes comme externes.
« À bas la trahison ! », conclut-il. Et surtout : « Vive Patrice Emery Lumumba. » Un siècle après sa naissance, la parole du père de l’indépendance continue de brûler — et d’éclairer.
Infos27