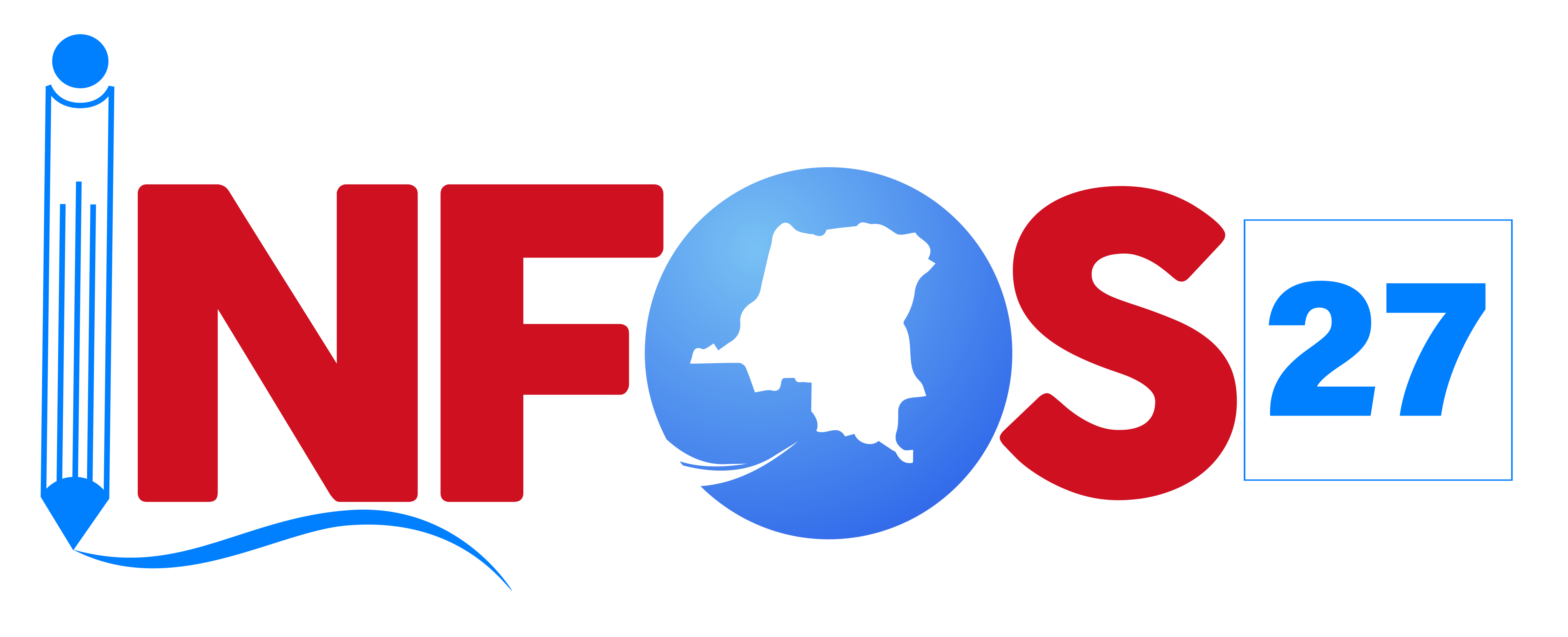Devant la tribune des Nations unies à New York, le président congolais Félix Tshisekedi a choisi de tourner le regard vers l’avenir. Alors que la République démocratique du Congo s’apprête à siéger, en 2026 et 2027, comme membre non permanent du Conseil de sécurité, il a présenté une feuille de route ambitieuse : faire de son pays une voix constructive et engagée au service de la paix mondiale. Son discours, prononcé mercredi 24 septembre lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale, a mis en exergue deux priorités indissociables — la paix et la sécurité d’une part, la prévention et la résolution des conflits d’autre part. S’appuyant sur l’expérience douloureuse de l’Est congolais, mais aussi sur le potentiel géopolitique et environnemental de son pays, Félix Tshisekedi a promis de contribuer activement au Nouvel Agenda pour la paix. Une posture offensive qui marque l’ambition d’une RDC décidée à transformer sa tragédie en levier de solutions globales.
À la tribune des Nations unies, mercredi 24 septembre, Félix Tshisekedi a déployé une vision qui dépasse les frontières congolaises. Son intervention devant la 80ᵉ session de l’Assemblée générale s’est voulue à la fois un plaidoyer pour la reconnaissance des souffrances de son peuple et une projection vers l’avenir : la République démocratique du Congo (RDC) siègera, en 2026 et 2027, comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Un mandat que le chef de l’État a présenté comme une responsabilité historique.
Une participation « constructive et holistique »
Remerciant les États membres pour leur confiance, Félix Tshisekedi a promis une participation « résolument constructive et holistique » de la RDC. Deux axes guideront cette contribution : « paix et sécurité » d’une part, « prévention et résolution des conflits » de l’autre. Loin d’une rhétorique de circonstance, le président congolais a souligné que l’expérience tragique de son pays, ravagé par trois décennies de violences dans l’Est, confère à Kinshasa une légitimité particulière.
« Nous entendons contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Nouvel Agenda pour la paix », a-t-il insisté, en référence au plan lancé par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en 2023. La RDC, a-t-il ajouté, mettra son « potentiel et son expérience » au service d’une réforme des opérations de maintien de la paix et d’une adaptation du système de sécurité collective.
La réforme du Conseil de sécurité au cœur du plaidoyer
Sans détour, le président congolais a rappelé la « position commune africaine » issue du Consensus d’Ezulwini et de la Déclaration de Syrte : l’Afrique doit obtenir deux sièges permanents et deux sièges supplémentaires de membres non permanents. Pour Félix Tshisekedi, il n’est plus acceptable que le continent, avec ses 54 États et plus d’un milliard d’habitants, reste marginalisé dans les décisions engageant la sécurité mondiale.
Cette revendication, ancienne mais toujours inaboutie, prend une résonance particulière au moment où la RDC s’apprête à siéger. Kinshasa veut utiliser cette visibilité pour rappeler l’urgence d’une gouvernance internationale plus équitable.
Gouvernance des ressources et lutte contre l’impunité
Le discours a également porté sur un enjeu central : l’exploitation illégale des ressources naturelles, moteur persistant des conflits. Félix Tshisekedi a présenté la RDC comme un acteur engagé dans la transparence et la traçabilité des minerais stratégiques. Rompre le lien entre « rentes minières et financement des groupes armés » est, selon lui, une condition indispensable à la paix.
Le président a plaidé pour une coopération internationale accrue en matière de contrôle, de sanctions et de lutte contre la corruption. Il a relié ce combat à d’autres agendas indissociables : droits humains, justice transitionnelle, autonomisation des femmes et inclusion des jeunes.
De la tragédie congolaise à une contribution mondiale
Si le chef de l’État a rappelé, avec gravité, les drames vécus par son pays — massacres, déplacements massifs, « génocide silencieux » —, c’est moins pour s’enfermer dans une posture victimaire que pour démontrer l’urgence d’agir. « Nous ne sollicitons ni charité, ni commisération : nous exigeons justice, vérité et dignité », a-t-il déclaré, appelant à la création d’une commission d’enquête internationale sur les crimes commis à l’Est de la RDC.
Mais, fidèle à la tonalité de son allocution, Félix Tshisekedi a surtout insisté sur la capacité de son pays à être une « terre de solutions ». Sur le plan sécuritaire comme environnemental, la RDC entend mettre en avant ses atouts — sa biodiversité, ses forêts, ses ressources énergétiques — pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la consolidation d’une paix durable.
Une ambition internationale assumée
À l’heure où l’ONU fête ses 80 ans, le président congolais a choisi de projeter son pays comme un acteur crédible du multilatéralisme. La RDC, a-t-il rappelé, est membre de la Coalition mondiale contre Daech, engagée dans la lutte contre le terrorisme, et signataire de multiples initiatives climatiques.
« La République démocratique du Congo aspire à la paix, à la justice et au développement. Elle est prête à agir, à vos côtés, pour une Organisation des Nations unies plus forte, plus inclusive et plus juste », a-t-il conclu.
Au moment où son pays se prépare à entrer au Conseil de sécurité, ce discours sonne comme un manifeste : transformer la souffrance d’une nation meurtrie en un engagement universel pour la paix. Une ambition qui, si elle se concrétise, pourrait donner à la RDC un rôle inédit dans l’histoire récente de l’ONU.
Infos27