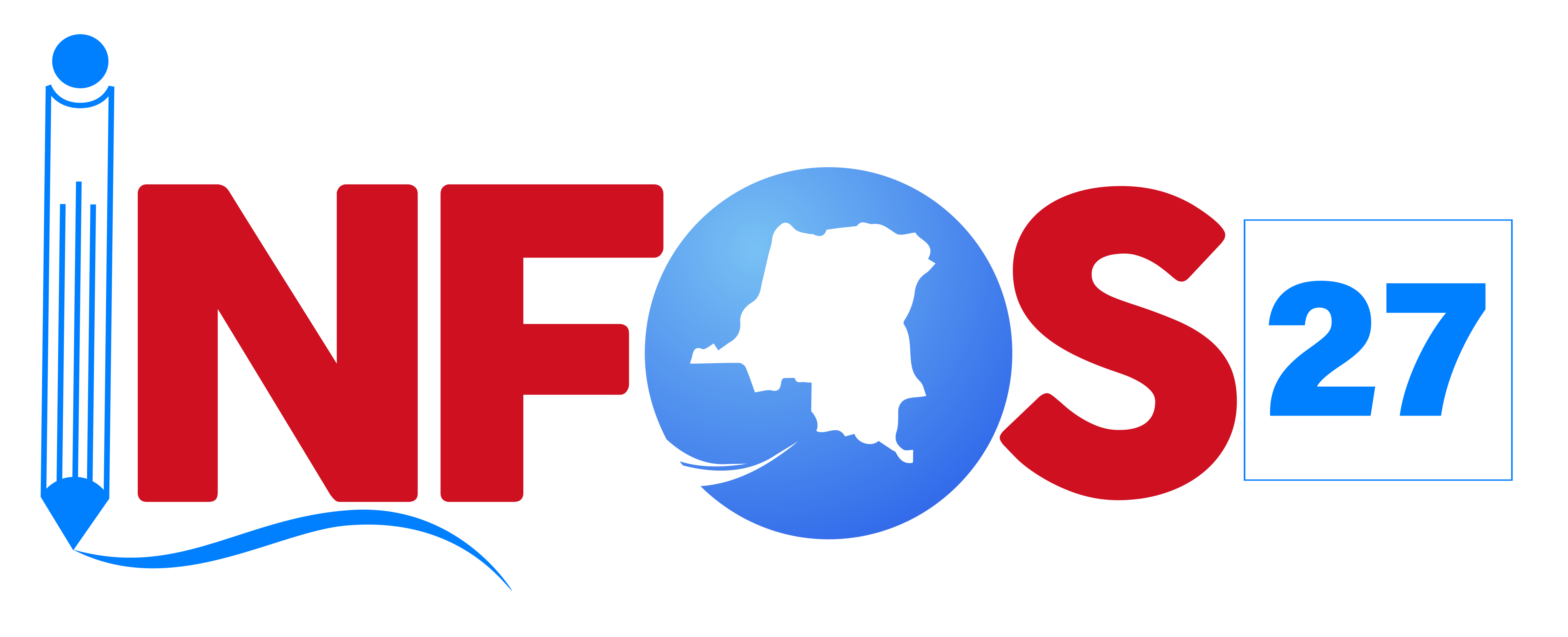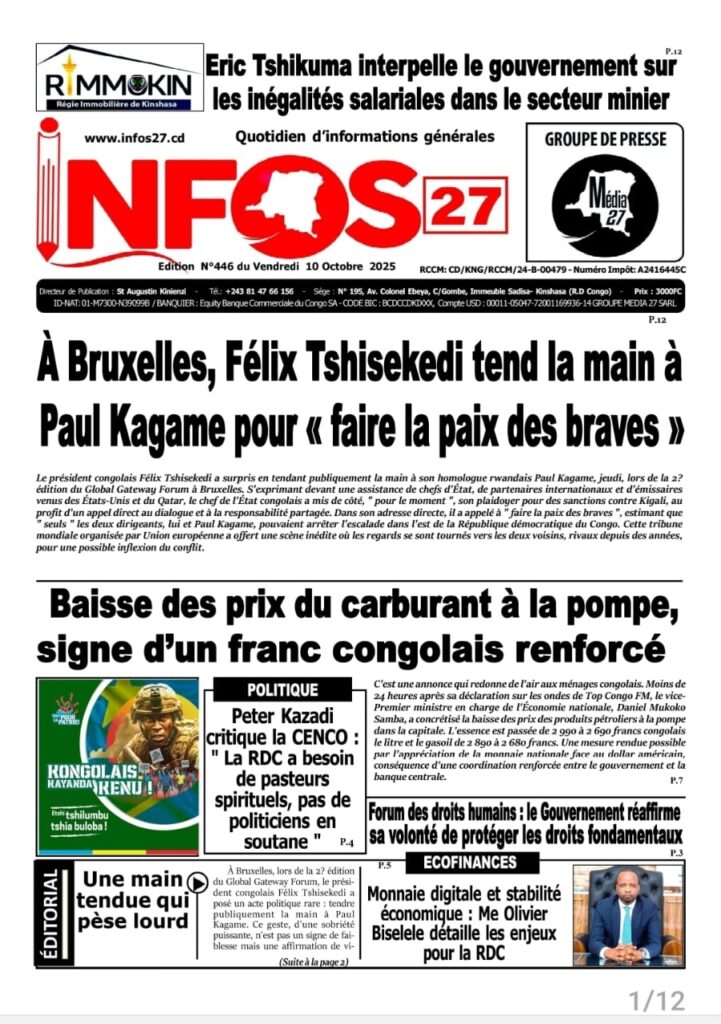Pour bien cerner notre sujet, il est préalablement nécessaire d’apporter quelques précisions terminologiques concernant la révision constitutionnelle. Les défenseurs et les pourfendeurs de la réforme constitutionnelle parlent tantôt d’une révision, tantôt d’un changement de la Constitution, voire de l’adoption d’une nouvelle Constitution.
C’est la France qui a inventé les concepts de révision totale et de révision partielle. En ce qui concerne la révision totale, elle consiste à remplacer une constitution par une autre, et ce remplacement s’effectue dans le respect des règles, ce qui implique que la nouvelle constitution succède à l’ancienne conformément aux dispositions de celle-ci (1).
Changer la Constitution, c’est évidemment procéder à une révision totale. Elle se caractérise par le remplacement d’une constitution par une autre.
La révision totale relève du constituant originaire, qui détient un pouvoir insubordonné, c’est-à-dire un pouvoir initial, autonome et inconditionné (2). Par « pouvoir insubordonné et inconditionné », l’auteur entend que ce pouvoir ne peut être subordonné à aucun autre pouvoir, y compris à la constitution elle-même. Nonobstant ce pouvoir insubordonné, le constituant originaire est tenu de respecter la séparation des pouvoirs ainsi que les droits fondamentaux des citoyens consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La révision totale est obligatoirement soumise à l’approbation de la population par voie référendaire, afin d’assurer sa légitimation démocratique. L’ancien vice-président du Conseil d’État français, Jean-Marc Sauvé, avait bien démontré que « le référendum, en permettant une participation directe des citoyens, est un instrument de consolidation de la démocratie ».
La révision totale, caractérisée par le remplacement d’une constitution par une autre, peut, d’une part, avoir pour objet de changer le régime politique d’un État, de remettre une constitution sur le métier pour approfondir ses principes et corriger les défauts révélés par son usage, ou encore de moderniser une constitution ancienne et de l’adapter au goût du jour (3). Il s’agit bel et bien d’adapter la constitution à la réalité sociale, de la mettre à jour et de répondre aux aspirations de la population.
D’autre part, la révision totale intervient, comme l’affirme Mathieu Aldjina : « Le changement de la constitution procède d’une crise : après une interruption de la vie constitutionnelle d’un État à la suite d’événements plus ou moins dramatiques (conflit armé, coup d’État, révolution, insurrection populaire) » (4).
En ce qui concerne la révision partielle, elle maintient la constitution tout en la modifiant, toujours dans le respect des règles et sur un objet déterminé. Le fait de reformer certains articles correspond évidemment à la révision partielle.
La révision partielle de la constitution est illicite si elle est opérée en dehors de la procédure prévue par la constitution. Il est généralement admis que l’objectif d’une révision partielle est d’améliorer la constitution en vigueur sans aller jusqu’à sa transformation. Certaines catégories de la doctrine distinguent la révision du changement de la constitution. Comme le rappelle Nahm-Tchougli, en s’appuyant sur d’autres travaux, la révision de la constitution est l’acte par lequel on procède à une modification de la constitution selon le régime que celle-ci a elle-même prévu (5), tandis que le changement de constitution correspond à l’opération visant à en rédiger une nouvelle (6).
Il convient de signaler que la France, qui est à l’origine de ces concepts, a fait la distinction entre révision totale et révision partielle, tandis que d’autres doctrinaires différencient révision et changement de constitution. La Constitution congolaise du 18 février 2006 n’a pas expressément fait cette distinction : elle est prévue seulement au titre VIII, intitulé « De la révision constitutionnelle », et l’article 218 fixe la procédure de révision, ce qui montre à suffisance qu’il s’agit d’une révision partielle.
La Constitution du 18 février 2006 n’a pas planifié ni programmé sa « mort » (révision totale), mais prévoit plutôt une « thérapie » (révision partielle) en cas de besoin. La question qui se pose est donc la suivante : lorsque la constitution ne prévoit pas sa révision totale (changement de la constitution), peut-elle néanmoins être révisée totalement ?
La réponse est oui, en vertu du principe général du droit : ce qui n’est pas interdit est permis. Lorsque la constitution est muette, elle peut être complétée par les sources du droit telles que la loi, la jurisprudence, les principes généraux du droit et la coutume constitutionnelle. Le professeur Kpodar affirme : « Aujourd’hui, il est clair que le droit constitutionnel ne se trouve pas toujours dans la constitution ».
La révision constitutionnelle qui a abouti à la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 a porté sur certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Il s’agit de la première révision de cette Constitution. Curieusement, la loi constitutionnelle a révisé deux matières intangibles définies par l’article 220, liées à l’indépendance judiciaire (article révisé 149) et aux prérogatives des provinces (articles révisés 197 et 198). Le constituant dérivé, au lieu de commettre l’irrégularité flagrante de réviser des articles intangibles, aurait dû procéder à la révision de l’article 220 afin de rendre tangibles les articles révisés 147, 197 et 198.
Ntumba Bettens
avocat- chercheur en droit public interne et internationale
Notes de bas de pages
(1) L’équilibre des pouvoirs, p 456, JEAN FRANÇOIS AUBERT
(2) GEORGES BURDEAU, traité de science politique tome VII : la Démocratie gouvernant, son assise sociale et sa philosophie, Paris, librairie générale du droit et jus prudence 1973 ppp517
(3) Equilibre des pouvoirs, opcit, p 456 JEAN FRANÇOIS AUBERT
(4) MATHIEU ALDJINA MOUTOUGOU, le changement de la constitution à droit constitutionnelle
(5) ARDANT « la révision constitutionnelle en France problématique générale » en révision de la constitution journée d’études du 20 Mars et le 16 Décembre 1992, association française du constitutionaliste, économico, 1993, p80 cité par NAHM TCHOUGLI (M) « la dernière vague du constitutionalisme en Afrique noire francophone : la désacralisation de la constitution, RCC, 2020/le 04 semestriel, p14
(6) NAHM – TCHOUGLI (M) « la dernière vague du constitutionnalisme en Afrique noire Francophone, la désacralisation de la constitution » prec, voir aussi moderne (F) « réviser » la constitution. Analyse comparative d’un concept indéterminé » Paris, Dalloz, 2006, p97