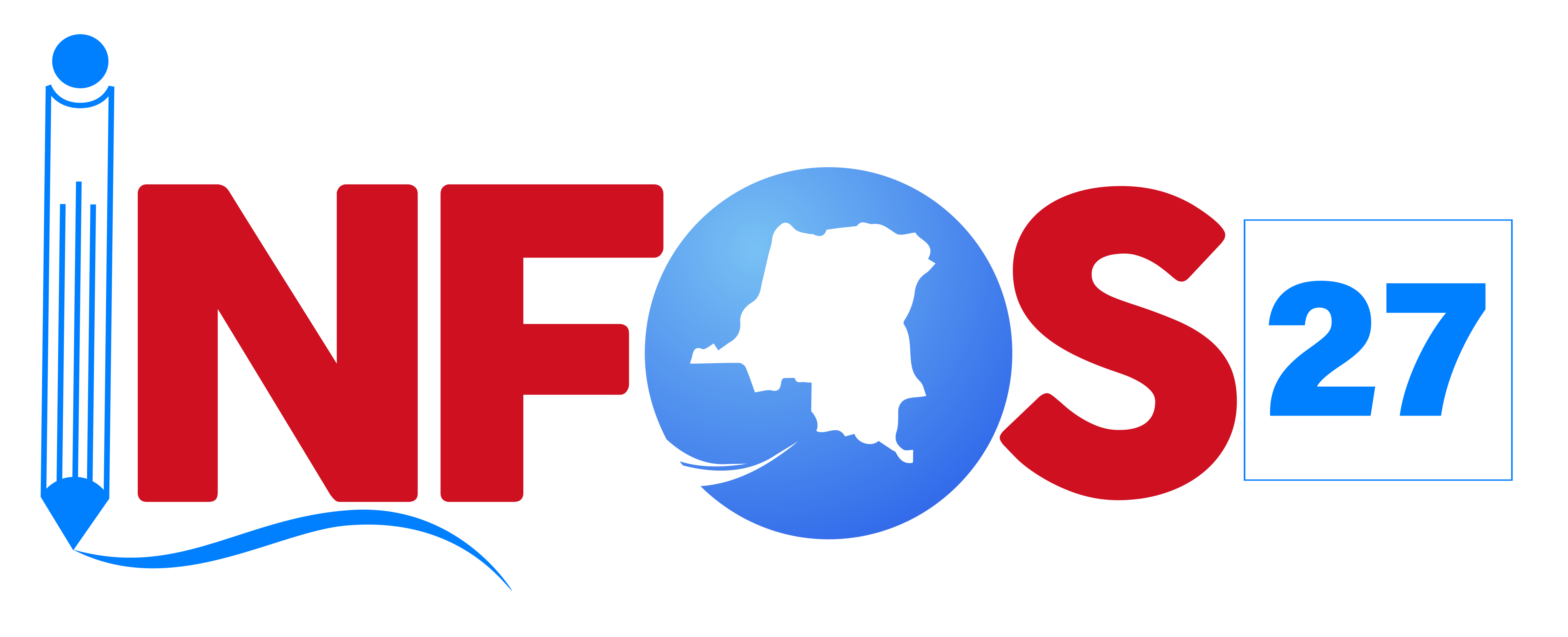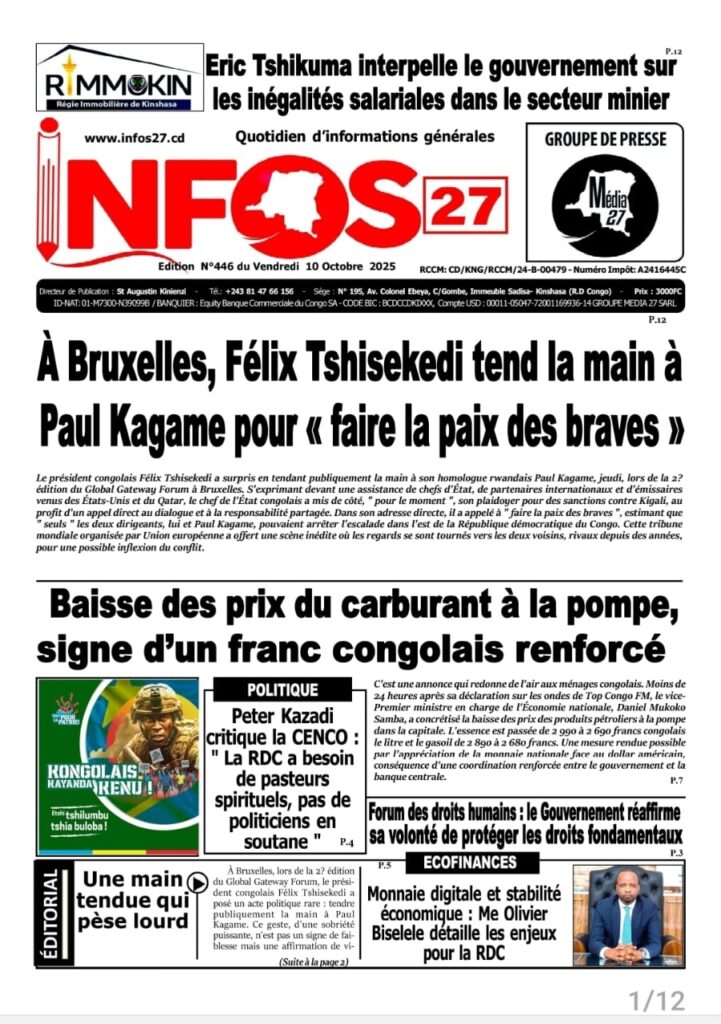En trois jours, l’Émir du Qatar a réussi à imposer Doha comme un acteur désormais incontournable entre deux capitales que tout oppose, mais que la géographie et l’histoire obligent à se parler : Kigali et Kinshasa. L’initiative n’est pas anodine. Elle survient au moment précis où le Processus de Doha tente d’esquisser un cadre politique, encore fragile, pour sortir le conflit de l’Est de la RDC de l’impasse. Et elle souligne un fait essentiel : malgré les doutes, malgré les pressions, la RDC avance, assume ses choix et prend toute sa place dans le nouveau jeu diplomatique. Le constat est clair. L’accord-cadre signé le 15 novembre n’est ni une panacée ni un aboutissement. Mais il est devenu le pivot d’une méthode : celle d’un cessez-le-feu permanent à construire, d’une transition sécuritaire à négocier, d’une justice à penser, d’un État à réaffirmer. En le signant, Kinshasa a pris une responsabilité politique majeure : accepter de s’asseoir à une table étroite, avec un adversaire direct, sous le regard d’un médiateur qui ne se contente plus d’observer. Doha, en effet, n’est plus un simple facilitateur ; c’est désormais un centre de gravité diplomatique. Et c’est là que réside la nouveauté. Car dans un environnement où les mécanismes africains peinent, où les partenaires traditionnels hésitent, la RDC a fait le choix courageux de diversifier ses alliances. Les six accords signés à Kinshasa ne répondent pas seulement à des besoins techniques : ils disent une stratégie. Moderniser les ports, fluidifier les corridors, renforcer la justice, structurer la jeunesse, ancrer des consultations politiques régulières : c’est une manière de rappeler que la paix se gagne autant par les institutions que par les armes. Et que le développement économique n’est pas un luxe mais une condition de la stabilité. Il serait naïf d’ignorer les périls. Le Processus de Doha ne survivra que si Kigali renonce à jouer la carte de l’ambiguïté sécuritaire et si les groupes armés cessent d’être des leviers d’influence. Il ne prospérera que si Kinshasa maintient sa ligne : fermeté sur l’intégrité territoriale, ouverture sur les mécanismes de sortie de crise. Mais il serait injuste d’ignorer les progrès. La RDC n’est plus une simple variable d’ajustement ; elle propose, négocie, structure ses alliances et impose ses priorités. Doha, en s’invitant dans cette équation, ne déstabilise pas la région : il crée une opportunité. Celle de rappeler que la désescalade n’est pas une concession, mais une nécessité ; que la coopération économique n’est pas une diversion, mais un levier ; que la paix n’est pas un slogan, mais une architecture à bâtir pas à pas.
En trois jours à peine, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a tissé une séquence diplomatique sans précédent entre Kigali et Kinshasa, confirmant l’ambition du Qatar de s’imposer comme un acteur incontournable de la stabilisation des Grands Lacs et de l’intégration économique de l’Afrique centrale. Après une visite qualifiée de « hautement symbolique » au Rwanda, l’Émir a poursuivi son offensive diplomatique à Kinshasa, où Félix Tshisekedi l’a accueilli le 21 novembre pour un entretien élargi à la coopération, à la sécurité régionale et au Processus de Doha. Cette démonstration de vitesse diplomatique ne procède pas d’un simple protocole : elle s’inscrit dans un moment où les choix politiques deviennent décisifs pour l’avenir de la région.
À Kigali, Paul Kagame a évoqué des échanges « productifs » avec son « frère et ami », signe d’une entente bilatérale soigneusement entretenue, même si les divergences sur le conflit de l’Est restent profondes. À Kinshasa, Félix Tshisekedi a tenu un discours plus ferme, soulignant « l’implication directe » de l’Émir dans la médiation engagée entre la RDC et la coalition AFC/M23. « Nous sommes déterminés à restaurer la paix, mais sur la base d’un respect strict de notre intégrité territoriale », a rappelé un conseiller proche du chef de l’État, traduisant la ligne rouge fixée par Kinshasa.
Un tournant politique dans un moment décisif
Le Processus de Doha, dont l’accord-cadre du 15 novembre constitue la pierre angulaire, formalise une méthodologie, un calendrier et huit protocoles à négocier, de la cessation permanente des hostilités à la transition sécuritaire, en passant par la justice transitionnelle, l’accès humanitaire et la restauration de l’autorité de l’État. Cet accord, signé par Sumbu Sita Mambu pour la présidence congolaise, Benjamin Mbonimpa pour l’AFC/M23 et Mohammed al-Khulaifi pour le Qatar, est présenté par les partenaires internationaux comme un « tournant », mais nul n’ignore sa fragilité.
Les États-Unis, qui ont rappelé lors de la réunion JSCM de Washington l’importance d’un mécanisme de coordination robuste face aux groupes armés encore actifs, voient d’un bon œil la montée en puissance de Doha. À Bruxelles comme à Paris, on salue un « progrès réel », tout en avertissant que « le processus devra survivre à l’épreuve du terrain ».
Dans la région, l’équation reste claire : l’initiative qatarie ne réussira que si Kigali et Kinshasa acceptent une désescalade vérifiable. C’est précisément ce que l’Émir cherche à sceller.
En reliant les deux capitales en moins de vingt-quatre heures, Sheikh Tamim a envoyé un message d’autorité : Doha n’entend pas jouer les médiateurs passifs. Le Qatar assume un rôle de puissance stabilisatrice, s’autorisant même à combler le vide laissé par des mécanismes africains souvent paralysés et une communauté internationale ralentissant ses engagements dans les Grands Lacs.
Six accords bilatéraux pour ancrer un partenariat durable
La séquence ne s’est pas limitée au dossier sécuritaire. À Kinshasa, six accords ont été signés en présence des deux chefs d’État. Ils couvrent des domaines aussi sensibles que stratégiques : ports, justice, mobilité diplomatique, aide humanitaire, jeunesse et consultations politiques.
Le partenariat portuaire entre Mwani Qatar et l’ONATRA vise à moderniser les infrastructures congolaises et à fluidifier les chaînes logistiques d’un pays enclavé par son propre gigantisme. L’accord de coopération judiciaire doit renforcer les échanges techniques et les procédures d’entraide, un point crucial dans une région où la porosité des frontières alimente les trafics.
L’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux marque une volonté de fluidifier les échanges institutionnels, alors que d’autres puissances tardent à accorder ce type de facilités à la RDC.
Le Fonds du Qatar pour le développement (QFFD) financera une réponse multisectorielle au Sud-Kivu, l’une des provinces les plus meurtries par deux décennies de conflits. Un mémorandum dédié aux secteurs de la jeunesse et du sport cherche à renforcer le capital humain, tandis qu’un accord institue des consultations politiques régulières entre les ministères des affaires étrangères des deux États.
Pour Kinshasa, ces accords offrent un message politique clair : diversifier ses alliances, réduire sa dépendance aux partenaires traditionnels et installer un contrepoids diplomatique face aux ambitions régionales du Rwanda.
L’économie, levier stratégique de la diplomatie qatarie
La diplomatie économique du Qatar, déjà solidement implantée dans la région, constitue désormais l’autre pilier de sa stratégie. En RDC, la visite du 2 septembre de Sheikh Al-Mansour Bin Jabor Bin Jassim Al Thani avait ouvert la voie à une lettre d’intention de 21 milliards de dollars, couvrant mines, agriculture, énergie, télécoms et infrastructures. L’ouverture de l’ambassade du Qatar à Kinshasa en mai 2025, l’intégration de la RDC au réseau de Qatar Airways en 2024 et l’entrée de la Qatar Investment Authority dans le capital d’Ivanhoe Mining illustrent cette expansion.
Au Rwanda, Doha poursuit les négociations entamées en 2019 pour une participation de 49 % au capital de RwandAir, tout en restant un acteur majeur dans le projet de l’aéroport international de Bugesera. L’Émirat consolide ainsi un double ancrage, jouant simultanément la carte rwandaise et la carte congolaise, sans jamais renoncer à son objectif : devenir un pivot régional.
Doha, nouveau centre de gravité entre deux capitales
Cette stratégie, à la fois économique, diplomatique et politique, s’inscrit dans un moment charnière. Kinshasa cherche à isoler le M23, Kigali veut préserver son influence, et les partenaires extérieurs cherchent une zone d’engagement maîtrisée. Le Qatar, lui, avance ses pions avec méthode : médiation active, investissements massifs, présence institutionnelle renforcée.
Pour la première fois depuis longtemps, un acteur extérieur apparaît capable de parler simultanément à Kigali et à Kinshasa, tout en assumant un rôle de garant politique. « Le Qatar veut être le faiseur de paix que personne n’attendait », analyse un diplomate africain. Cette ambition s’affirme au moment où les Grands Lacs cherchent une voie durable vers l’apaisement.
La tournée de Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, loin d’être anecdotique, marque l’entrée de Doha dans une nouvelle ère : celle d’un pouvoir qui revendique son influence, assume ses choix et n’hésite pas à peser dans le jeu politique des Grands Lacs. Un pari risqué, mais désormais incontournable pour les capitales de la région.
Infos27