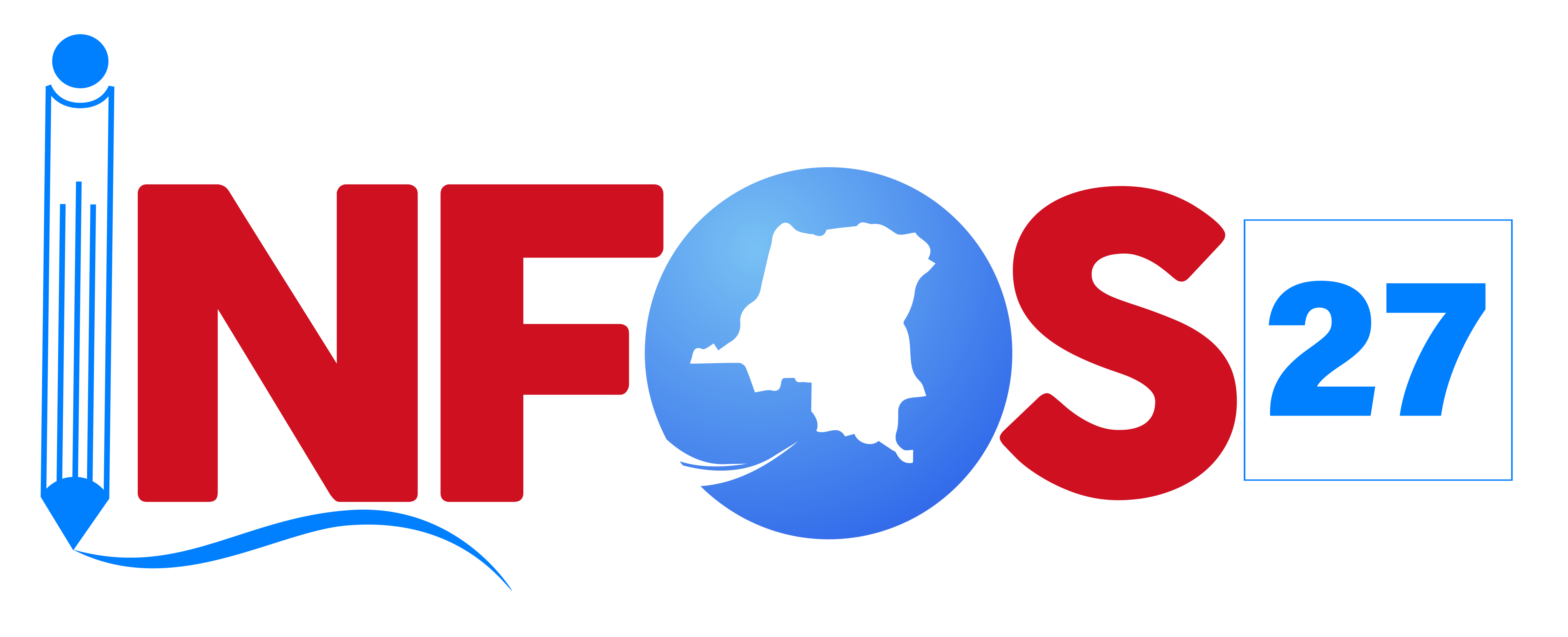La publication de la composition du nouveau gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, ou autrement appelé Suminwa II, a provoqué de vives réactions auprès des Congolais, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. D’aucuns ont fait part de leur déception quant à ce remaniement gouvernemental. Pas de grand chambardement attendu. Les médias et les réseaux sociaux se sont enflammés. Écrivain, analyste politique et conférencier, Gaspard-Hubert Lonsi Koko, donne son avis sur cette actualité qui défraye la chronique en RDC.
En votre qualité d’analyste politique, quel regard portez-vous sur la composition du gouvernement Suminwa II publiée, le vendredi 8 août 2025 ?
La gestion d’un pays n’étant pas forcément un long fleuve tranquille, un remaniement gouvernemental peut dans l’absolu être considéré comme une excellente initiative. Il faudra seulement veiller à éviter des malencontreuses aventures comme l’hypothétique alliance de triste mémoire entre le Cash de Félix Tshisekedi et le Fcc de Joseph Kabila, ou le débauchage de quelques partisans de l’ancien parti au pouvoir, à savoir le Pprd, en vue de la création de l’Union sacrée pour la nation. Espérons que la configuration du tout nouveau gouvernement ne générera pas encore une fois des conséquences contreproductives du mariage de la carpe et du lapin.
Félix Tshisekedi et Judith Suminwa Tuluka souhaitaient nommer un nouveau gouvernement resserré et ouvert aux autres forces socio-politiques congolaises. Pourtant, il a subi moins de changement attendu par rapport à la précédente équipe gouvernementale. Quel est votre commentaire ?
Il est difficile de gouverner, surtout quand il faut s’entendre avec des individus issus de différentes obédiences sur des actions à mener et la mise en place des projets gouvernementaux. Par conséquent, un simple raisonnement étant insuffisant, un gouvernement remanié doit normalement apporter un nouveau souffle. Or, dans le cas en l’espèce, on a du mal à percevoir un autre élan. L’ouverture à d’autres structures politiques et à la société civile est quasiment minime. En tout cas, si l’action de remanier ne peut tenir d’une définition politique, elle doit néanmoins être le résultat d’un accord programmatique quand bien même cela est à la fois le pire et le meilleur des actes. Il n’y a pas de démocratie, ni d’entente politique, sans contrat socio-politique.
Des voix se sont élevées, à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour exprimer leur mécontentement face à la composition de ce gouvernement qui se caractériserait « non pas par le renouveau attendu, mais plutôt par la reconduction d’un grand nombre de ministres sans bilan convaincant ». Cette remarque vous paraît-elle pertinente ?
Rien de surprenant à une telle réaction de la part de nos compatriotes, dès lors que l’attente du remaniement gouvernemental avait suscité un grand espoir s’agissant de la constitution d’un gouvernement de crise ou de combat, ou alors de salut public. Cela n’aurait offusqué personne si la composition de cette équipe était équilibrée et, surtout, l’œuvre d’un accord programmatique. Un programme est en principe l’affaire des partis politiques, ainsi que des forces vives de la nation, et non un arrangement d’un président de la République avec des individus considérés comme des institutions à part entière. Un gouvernement resserré aurait donc pu éviter les doublons et garantir la détermination propre à l’efficacité et à l’espérance.
D’aucuns sont plus critiques vis-à-vis de ce remaniement, et souhaitent d’ailleurs que le président, Félix Tshisekedi, dissolve ce gouvernement. Souscrivez-vous à leurs desiderata ?
Le vin est déjà tiré, constate-t-on. Faudrait-il pour autant le boire jusqu’à lie ? Le peuple étant le souverain primaire, il faudrait l’entendre et satisfaire ses desiderata. Encore faudrait-il que le futur gouvernement soit le fruit d’une alliance, d’une coalition sur des orientations adoptées en guise de programme commun qui s’imposerait comme charte pouvant sérieusement et durablement engager les parties contractantes sur la base de l’honnêteté et de la conviction. Et le président de la République devrait en être le garant.
Martin Fayulu et ses affidés ont refusé d’y participer et ont dit non par « patriotisme et conviction mais pas par défi ». N’est-ce pas simplement du ressentiment ?
Martin Fayulu Madidi et ses partisans ont, comme d’ailleurs tout être humain, des qualités et des défauts. Il ne me revient pas de les juger sans aucun discernement. N’empêche que le fait de refuser une proposition par défi n’est pas le propre d’un acte par excellence constructif. Mais, même s’il arrive que l’on change parfois d’avis avec le temps, les actes et volte-face qui ont émaillé les parcours des uns et des autres peuvent permettre à chacun de nourrir consciencieusement sa réflexion sur les convictions et intentions de nos acteurs politiques. Le meilleur pari étant toutefois celui que l’on peut faire sur l’être humain, il vaudrait mieux œuvrer pour le triomphe de la démocratie, tout comme pour la consolidation de la cohésion nationale et de l’éveil patriotique.
D’après vous, quel avenir pour le « camp de la patrie » ?
Si l’histoire d’un pays est en très grande partie faite de continuités, il faut savoir saisir les moments opportuns qui consolideront de manière indélébile les fondements patriotiques. Ceux-ci marqueront à jamais le futur de tout un peuple. Concevoir le « camp de la patrie » comme un simple regroupement de partis politiques devant obligatoirement partager le pouvoir dans une sorte de gouvernement d’union nationale, par opposition aux structures ou individus agissant sur commande pour la balkanisation du Congo, est une vision restrictive, voire exclusive, au moment où l’on a besoin d’un dialogue inclusif. L’avenir du « camp de la patrie » doit plutôt être appréhendé comme une démarche pouvant permettre aux populations congolaises, toutes convictions et croyances confondues, de connaître enfin le bonheur, de savourer la vraie joie de vivre ensemble, de profiter des instants merveilleux en tant qu’individus libres jouissant des droits et ayant des devoirs envers la patrie. Et cet avenir heureux, l’œuvre d’un dialogue inclusif, ne doit pas aboutir à une redistribution ou partage des postes dans les instances étatiques, mais déboucher sur la mise en place des processus et mécanismes de la bonne gouvernance et les alternances démocratiques. De toute façon, me semble-t-il, la patrie est le monopole des Congolais qui en sont l’expression.
Que recommanderiez-vous à la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour qu’elle réussisse sa mission ?
À quel titre devrai-je le faire ? Qui suis-je, franchement, pour me permettre de prendre en toute unilatéralité une pareille directive ? Mais, comme citoyen congolais, je souhaiterais avec patriotisme, pour maintenir contre vents et marées le cap fixé par le président de la République, Félix Tshisekedi, en sa qualité d’armateur public, que la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, s’affirme davantage comme le vrai capitaine de cette équipe gouvernementale. À cet effet, seule l’harmonisation des contributions ministérielles et leur cohérence lui permettront de satisfaire les attentes tant escomptées au plus haut sommet de l’État.
Propos recueillis par Robert Kongo, correspondant en France