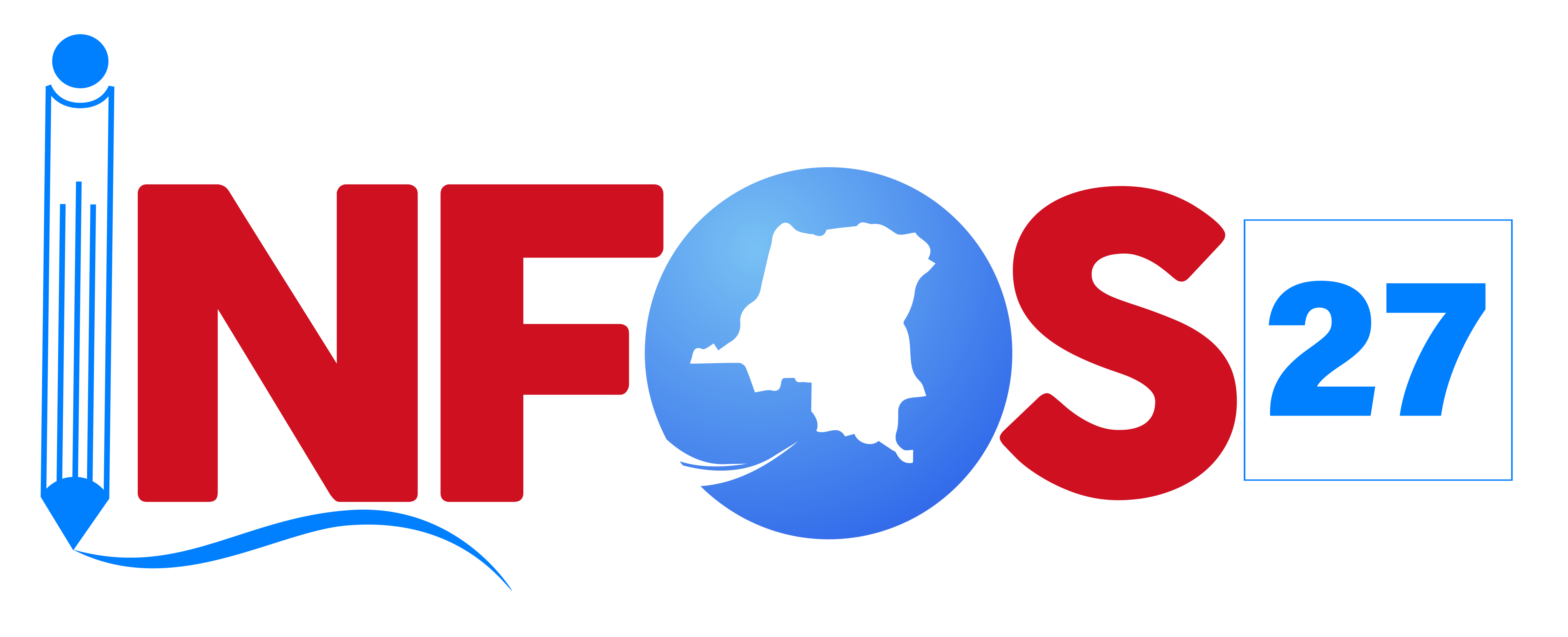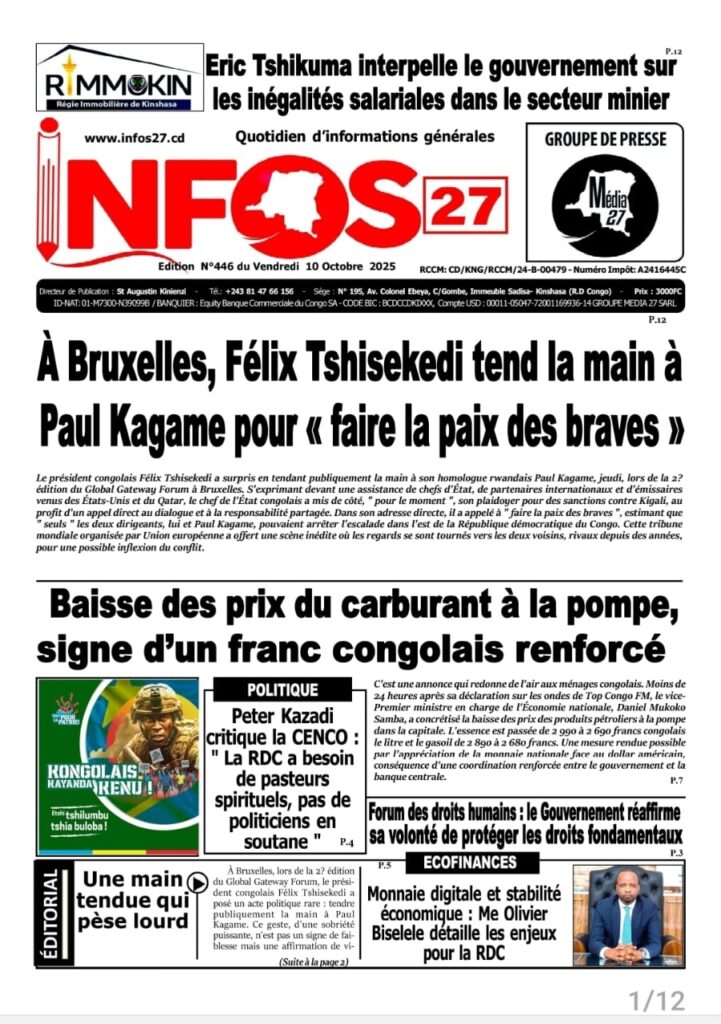Il y a des mots qui blessent plus que les balles, surtout lorsqu’ils viennent de ceux qui ont tenu le pays sous silence pendant près de deux décennies. Dans une séquence sidérante, Aubin Minaku, ancien président de l’Assemblée nationale et numéro deux du PPRD, s’est permis de railler le pasteur Kutino Fernando, figure emblématique de la résistance civile au régime Kabila. Huit années et trois mois de prison pour avoir lancé le mouvement « Sauver le Congo » : tel fut le prix payé par ce prédicateur pour avoir rêvé d’une démocratie que les caciques de l’ancien pouvoir refusaient alors de voir éclore. Aujourd’hui, voir l’un des architectes de ce système se draper dans le costume de donneur de leçons en démocratie confine à l’indécence. L’épisode en dit long sur le cynisme d’une certaine élite politique, prompte à se recycler sans jamais faire son examen de conscience. Dans un pays encore marqué par les plaies de l’autoritarisme, la mémoire ne devrait jamais être un accessoire.
Dans une sortie publique qui a fait réagir jusque dans les cercles les plus modérés de la société civile, Aubin Minaku, ancien président de l’Assemblée nationale et proche de Joseph Kabila, a tourné en dérision le pasteur Kutino Fernando, symbole des luttes pour la démocratie en République démocratique du Congo.
Celui que le régime de Kabila avait fait emprisonner pendant plus de huit ans pour avoir lancé une initiative politique intitulée « Sauver le Congo » est désormais la cible de railleries de la part de ceux-là mêmes qui l’avaient réduit au silence.
L’ironie est cruelle : Minaku, qui accuse aujourd’hui Félix Tshisekedi de dérive autoritaire, s’exprime librement, tandis que Kutino avait payé sa liberté au prix de sa santé et de sa dignité. À l’époque, l’appel du pasteur à une gouvernance éthique avait été perçu comme un acte de subversion. En 2025, il devient un souvenir gênant, qu’on préfère tourner en dérision plutôt que d’assumer.
La comparaison entre hier et aujourd’hui éclaire une différence fondamentale : critiquer le pouvoir en place n’envoie plus en prison, et cela, qu’on le veuille ou non, marque une rupture nette avec les méthodes d’hier.
Minaku, lui, semble avoir oublié que la démocratie congolaise qu’il prétend défendre aujourd’hui a été en partie forgée sur la souffrance de ceux qu’il méprise.
« Se moquer de ceux qui ont payé le prix fort pour que la démocratie ait une chance d’exister, c’est insulter l’histoire et mépriser la souffrance d’un peuple », résume un militant pro-démocratie de Kinshasa. Le propos a valeur d’avertissement. Car au-delà des mots, c’est une question de mémoire et de décence politique qui se pose.
Les anciens dignitaires du régime Kabila, nombreux à s’être reclassés sous de nouvelles étiquettes – hier PPRD, aujourd’hui AFC ou d’autres alliances de circonstance – peinent à convaincre qu’ils incarnent un renouveau. Sous des slogans rajeunis, les mêmes visages, les mêmes réflexes demeurent.
Ce n’est pas une alternance, c’est une mutation stratégique. Une mutation où le discours démocratique devient un outil de revanche politique, et non un engagement sincère pour l’avenir du pays.
Dans ce jeu d’ombres et de postures, le peuple congolais, désormais plus lucide, semble moins enclin à se laisser abuser. Il sait désormais distinguer les acteurs du changement des recycleurs du chaos. Et c’est sans doute là le plus grand acquis de cette décennie de transition démocratique : la mémoire, elle, ne s’efface plus.
JL/Correspondance particulière