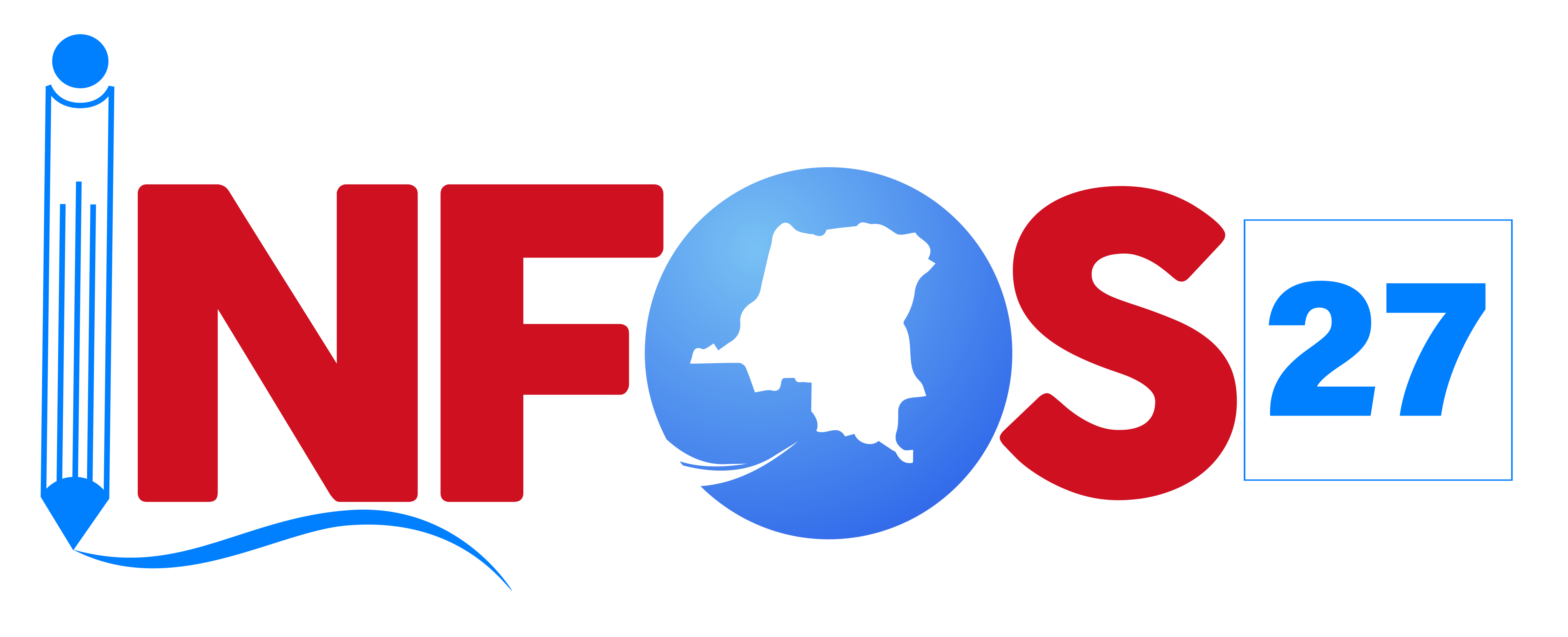Le temps des euphémismes est révolu. Au Palais des Nations à Genève, Félix Tshisekedi a jeté un pavé dans la mare de l’indifférence internationale en exigeant que l’on appelle enfin les choses par leur nom : les crimes commis en République démocratique du Congo depuis plus de trente ans ne sont pas de simples « tragédies humanitaires », mais bien des génocides. Dans une vidéo projetée à l’ouverture de la conférence scientifique sur le Genocost, le président congolais a rompu avec la liturgie des discours compatissants pour asséner une vérité nue, brutale : le Congo n’acceptera plus que ses millions de morts soient relégués dans les marges des rapports onusiens ou réduits à des statistiques froides.
Depuis 1993, l’Est congolais s’est transformé en un cimetière à ciel ouvert, une matrice de violences répétées où les massacres, les viols de masse et les déplacements forcés sont devenus une mécanique récurrente, alimentée par l’impunité et l’avidité des prédateurs.
Familles décimées, villages effacés de la carte, enfants condamnés à porter les stigmates de crimes planifiés : telle est la réalité qu’aucun jargon diplomatique ne saurait adoucir. Tshisekedi a choisi de la nommer pour ce qu’elle est : un enchaînement de crimes à caractère génocidaire, systématiques et organisés, qui visent non seulement à détruire des vies, mais aussi à effacer des communautés entières de l’histoire.
Le président congolais a rappelé la responsabilité de sa génération : briser le cycle « déni – impunité – récidive » qui ronge la région depuis trois décennies. C’est là tout le sens de son appel à la reconnaissance internationale des génocides congolais, car sans ce sceau juridique et moral, aucune paix durable ne pourra s’édifier. Nommer, c’est déjà juger.
Reconnaître, c’est ouvrir la voie à la justice, aux réparations et à la réconciliation. Car au bout du compte, il ne s’agit pas seulement de mémoire congolaise, mais d’un test de crédibilité pour le droit international et pour l’humanité tout entière.
Pitshou Mulumba