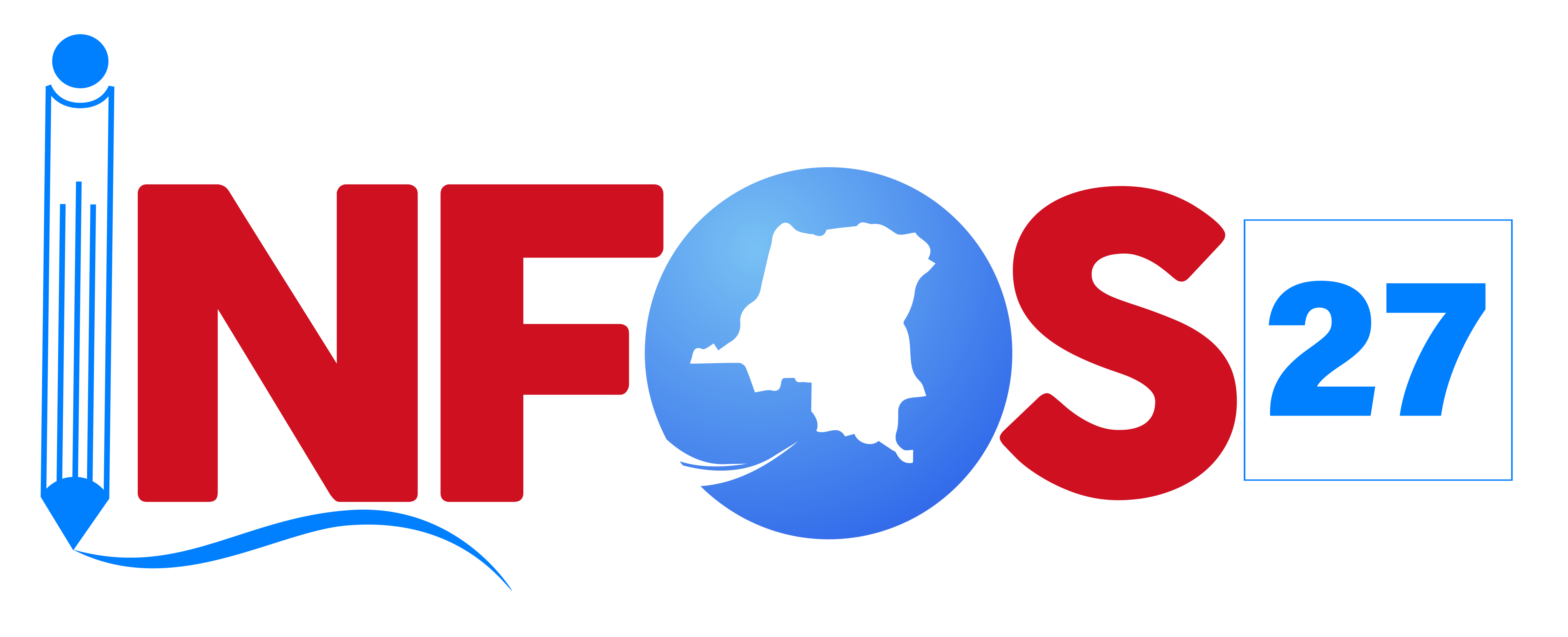Un rite ancestral menacé par les logiques de l’argent, au cœur d’enjeux culturels, sociaux et économiques.
Depuis les contreforts du mont Rwenzori jusqu’aux vallées fertiles de Butembo, la dot, appelée kucaluka dans la langue des Nande, est depuis des générations bien plus qu’un rite matrimonial : c’est un pilier de la cohésion sociale, un sceau d’alliance entre familles, un marqueur de respect, de solidarité et de continuité culturelle. Jadis incarnée par dix chèvres, quelques houes, une calebasse de bière de banane et une poignée de paroles solennelles, elle cristallisait l’aspiration à une union durable et équilibrée.
Mais dans une province du Nord-Kivu fragilisée par les conflits, l’inflation et une transition socio-économique brutale, ce qui fut un geste symbolique tend désormais à se transformer en transaction pure. La dot se monnaye en dollars, parfois à des montants astronomiques, introduisant une marchandisation inquiétante du mariage et exacerbant les fractures sociales.
Héritage sacré
Dans l’imaginaire Nande, le mariage coutumier ne saurait être réduit à une simple contractualisation. « Kucaluka, c’est donner ce que l’on a pour sceller un lien entre deux familles. Ce n’est ni vendre ni acheter », rappelle Mwami Muteba, chef coutumier à Oïcha. La dot, loin d’un prix, est un rituel d’engagement communautaire : elle consacre l’intégration de la femme dans sa nouvelle famille et crée un pacte implicite de solidarité et de respect mutuel.
Les dix chèvres traditionnellement exigées symbolisent la fertilité, la prospérité et la capacité du futur mari à nourrir et protéger sa famille. Autour d’elles gravitent d’autres gestes : des pagnes, des vivres, des outils agricoles. Ce n’est pas tant leur valeur monétaire qui compte que leur signification rituelle et affective.
Le poids croissant de l’argent
Or, ces dernières années, les jeunes hommes doivent désormais venir avec des enveloppes plutôt que des offrandes. Dans de nombreux cas, la dot est fixée d’emblée en dollars, parfois entre 2 000 et 5 000 USD, selon le niveau d’étude, la beauté ou même la réputation sociale de la jeune fille. « On m’a demandé 3 500 dollars pour une licenciée en droit », témoigne Jonas, 31 ans, enseignant à Beni. « J’ai dû abandonner. C’était au-dessus de mes moyens. »
Cette inflation est accentuée par une logique utilitariste de la dot, perçue de plus en plus comme un retour sur investissement. Une fille scolarisée jusqu’à l’université représente un « capital » qu’il faut rentabiliser. Les familles espèrent ainsi tirer un bénéfice du coût de son éducation, sans toujours consulter la principale concernée.
Quand l’argent étouffe le choix
Ce glissement a des conséquences profondes. Il réactive des rapports de force inégalitaires entre les sexes et les générations. De nombreuses jeunes femmes, comme Marie, 22 ans, diplômée en sciences infirmières, sont mariées contre leur gré à des hommes solvables, parfois beaucoup plus âgés. « Je n’ai pas choisi mon mari. Il avait l’argent, c’est tout ce qui comptait pour mes parents », confie-t-elle dans un murmure.
À l’inverse, des milliers de jeunes hommes, souvent au chômage ou précaires, se voient refuser le droit de se marier. Certains recourent à des unions libres, sans reconnaissance coutumière ni protection légale. D’autres s’endettent, empruntent à des amis ou à des créanciers, avec des risques d’insolvabilité durables.
Crise du modèle matrimonial
La dot marchande fragilise également le tissu social. Les mariages fondés sur des intérêts économiques s’avèrent souvent instables, menacés de séparation précoce. Des conflits surgissent entre familles sur fond de remboursements partiels, d’incompréhensions ou d’abus. Des affaires de dot atterrissent de plus en plus devant les tribunaux coutumiers, voire civils, à défaut de médiation réussie.
Certaines communautés observent aussi une montée des grossesses précoces non suivies de mariages, aggravant la vulnérabilité des jeunes mères et de leurs enfants. La reconnaissance coutumière devient un luxe inaccessible, accentuant les inégalités.
Le réveil des autorités coutumières
Face à cette dérive, les chefs coutumiers tentent de reprendre la main. « Il faut ramener la dot à son essence. Elle n’est pas un marché. Elle est une bénédiction », martèle Mwami Muteba. Dans plusieurs groupements de Lubero et Beni, des chartes coutumières ont été établies pour plafonner la dot ou interdire sa conversion en monnaie.
L’administration, de son côté, rappelle que la dot n’est pas une condition légale du mariage civil. « Le mariage repose sur le consentement mutuel, non sur une transaction », précise un agent de l’état civil à Butembo. Le Code de la famille congolais, révisé, encourage des pratiques respectueuses des droits des conjoints, notamment des femmes.
Femmes, ONG, et droits
Les associations locales de défense des droits humains, à l’instar du Réseau des femmes du Grand Nord, mènent des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les églises pour rappeler que « la femme n’est pas à vendre ». Elles plaident pour une dot symbolique, pour la liberté de choix et pour l’autonomisation économique des jeunes filles.
Des initiatives communautaires émergent : cercles de dialogue, fonds de solidarité matrimoniale, ateliers de réflexion sur la tradition. « Il ne s’agit pas d’abolir la dot, mais de lui redonner son humanité », estime Béatrice Kambale, militante à Oicha.
Comparaisons et résonances
La situation observée chez les Nande fait écho à des tendances régionales. Au Rwanda, en Ouganda ou dans certaines communautés du Kasaï, la dot connaît aussi une inflation alarmante, provoquant des débats sur sa légitimité et ses dérives. Mais c’est dans le Grand Nord du Kivu que l’enjeu semble le plus vif, tant la pratique est enracinée dans l’identité culturelle locale.
Dans un contexte de mutation sociale accélérée, la dot chez les Nande est à la croisée des chemins. Ni sa suppression ni son absolutisation ne semblent viables. Ce que réclament les jeunes, les sages et les femmes, c’est une refondation : une dot allégée, réhumanisée, enracinée mais non oppressive.
À Beni, Butembo ou ailleurs, les récits de souffrance comme ceux d’espoir s’accumulent. Ils témoignent d’un besoin urgent de conjuguer tradition et modernité, mémoire et équité, pour que le mariage redevienne un choix libre et un lien fécond.
« La dot doit unir, pas diviser », résume avec gravité le Mwami de Kalunguta. Une leçon de sagesse dans un monde où les équilibres anciens cherchent à survivre sous la pression de l’or et des billets verts.
Par Justin Mupanya, correspondant à Beni