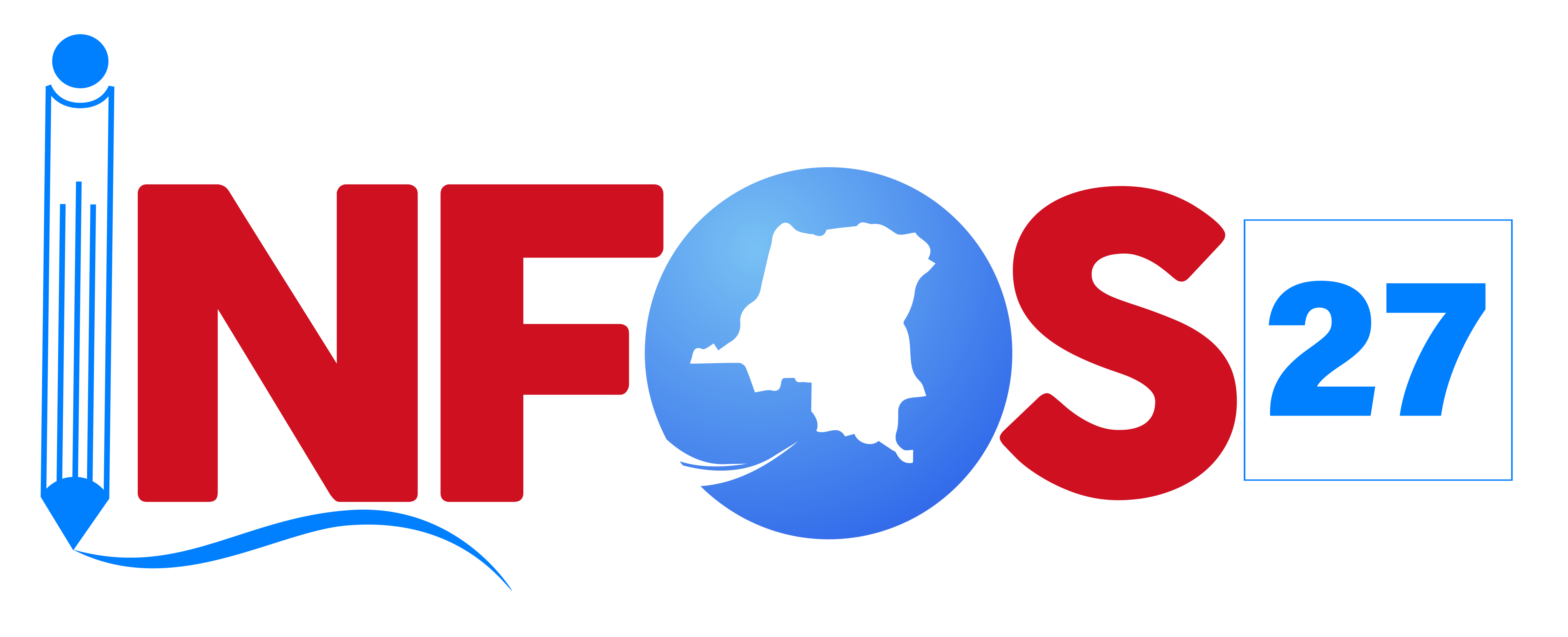Il n’y a plus de place pour l’ambiguïté : le Congo ne veut plus taire ses morts. Dans un message vidéo projeté lundi au Palais des Nations à Genève, Félix Tshisekedi a brisé le confort du silence international en exigeant que les crimes de masse commis en République démocratique du Congo depuis trois décennies soient enfin appelés par leur nom : des génocides. Ce plaidoyer, livré à l’ouverture de la conférence scientifique sur le Genocost, en marge de la 60ᵉ session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, s’est voulu à la fois une mise en accusation de l’oubli, une interpellation des consciences et une invitation à bâtir une justice qui répare. Car derrière les chiffres et les rapports s’étendent des réalités effroyables : villages anéantis, populations décimées, femmes et enfants broyés par des crimes planifiés, et un cycle de violences qui se perpétue dans l’impunité. Pour Kinshasa, l’heure est venue de sortir ce drame de l’ombre des rapports pour l’inscrire dans la lumière du droit international.
Depuis plus de trois décennies, l’est de la République démocratique du Congo (RDC) vit au rythme de conflits d’une brutalité extrême. Massacres, viols systématiques, déplacements massifs de populations : autant d’atrocités qui, selon Kinshasa, relèvent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, et parfois même du crime de génocide.
Lundi 8 septembre, à Genève, la voix du président congolais Félix Tshisekedi a résonné dans la salle XVII Emirates Room du Palais des Nations, à l’ouverture de la conférence scientifique sur le Genocost, organisée en marge de la 60ᵉ session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Dans un message vidéo projeté devant les diplomates, experts et responsables congolais présents, le chef de l’État a livré un plaidoyer solennel pour la reconnaissance internationale des génocides commis sur le territoire congolais et pour l’établissement d’un mécanisme robuste de justice transitionnelle.
« Depuis plus de trois décennies, nos populations payent tant de tribus humains insoutenables, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques », a-t-il déclaré d’emblée, posant les termes d’un discours empreint de gravité et d’une volonté de rupture.
Briser le cycle du silence et de l’impunité
Le président congolais a insisté sur « la responsabilité de sa génération » de rompre le cycle du « déni-impunité-récidive » qui, selon lui, entretient les violences dans l’est du pays. « Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d’une justice qui répare et d’une paix qui dure », a-t-il poursuivi.
 Son plaidoyer s’articule autour de trois axes : d’abord, la cartographie des faits à caractère génocidaire commis en RDC au cours des trente dernières années, ensuite l’établissement de l’existence de génocides sur le territoire au regard des critères du droit international, enfin la mise en place d’une architecture de justice transitionnelle adaptée aux réalités congolaises, garantissant vérité, poursuite et réparation.
Son plaidoyer s’articule autour de trois axes : d’abord, la cartographie des faits à caractère génocidaire commis en RDC au cours des trente dernières années, ensuite l’établissement de l’existence de génocides sur le territoire au regard des critères du droit international, enfin la mise en place d’une architecture de justice transitionnelle adaptée aux réalités congolaises, garantissant vérité, poursuite et réparation.
« Reconnaître un génocide, c’est protéger l’avenir en refusant l’oubli et le relativisme », a martelé Félix Tshisekedi, appelant les États, les organes des Nations unies, les organisations régionales et les juridictions nationales et internationales à s’associer à cette démarche.
Un plaidoyer inscrit dans le droit international
Dans son discours, le président congolais a réaffirmé l’ancrage de la RDC dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ainsi que dans l’ensemble des instruments pertinents du droit international. Cette référence explicite vise à inscrire son appel dans un cadre juridique universel, susceptible de convaincre au-delà des sensibilités régionales.
Le message se veut aussi inclusif : « Ce combat n’est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l’humanité », a-t-il assuré, en écho aux critiques parfois formulées sur la dimension ethnique des conflits dans la région.
Le chef de l’État a également salué le travail des survivants et des chercheurs, dont la documentation minutieuse et les efforts de mémoire constituent, selon lui, « la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation ».
Une mémoire encore vive
Le Genocost, terme forgé par des chercheurs congolais et repris par des associations de victimes, désigne l’ensemble des crimes de masse commis en RDC depuis les années 1990. Pour Kinshasa, il ne s’agit plus seulement de décrire les violences, mais d’obtenir une reconnaissance internationale de leur caractère génocidaire.
L’événement de Genève s’inscrit dans ce cadre, en marge des discussions officielles du Conseil des droits de l’homme, et se veut une tribune pour porter ce combat dans l’arène internationale. La projection du plaidoyer présidentiel, en ouverture de la conférence, avait pour but de donner un souffle politique à une rencontre scientifique et mémorielle.
« La paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l’esprit de la réconciliation », a lancé Félix Tshisekedi, en rappelant que la réparation des victimes et leur réintégration dans la vie sociale sont des conditions indispensables à la stabilité durable de la région.
Un appel aux partenaires internationaux
Au-delà du diagnostic, le président congolais a adressé une série d’appels directs aux différents acteurs présents à Genève. Aux États, il a demandé de « soutenir l’établissement d’un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d’enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire ». Aux organes des Nations unies et aux organisations régionales, il a recommandé de « conjuguer leurs efforts » pour garantir protection des civils aujourd’hui, justice pour les victimes d’hier et garanties crédibles de non-répétition demain.
Aux institutions de justice, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales, il a lancé un avertissement : « Faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l’impunité. »
Enfin, aux chercheurs et aux survivants, il a rendu hommage pour leur travail de documentation, de mémoire et d’accompagnement, indispensable à la reconnaissance et à la réparation.
En concluant son intervention, Félix Tshisekedi a voulu donner à son appel une dimension universelle : « Reconnaître un génocide, c’est protéger l’avenir en refusant l’oubli et le relativisme. » Le président a pris « l’engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l’établissement des vérités et des responsabilités, et à la garantie pour les victimes de leurs droits à la vérité, à la justice et à la réparation ».
Pitshou Mulumba, Envoyé Spécial à Genève