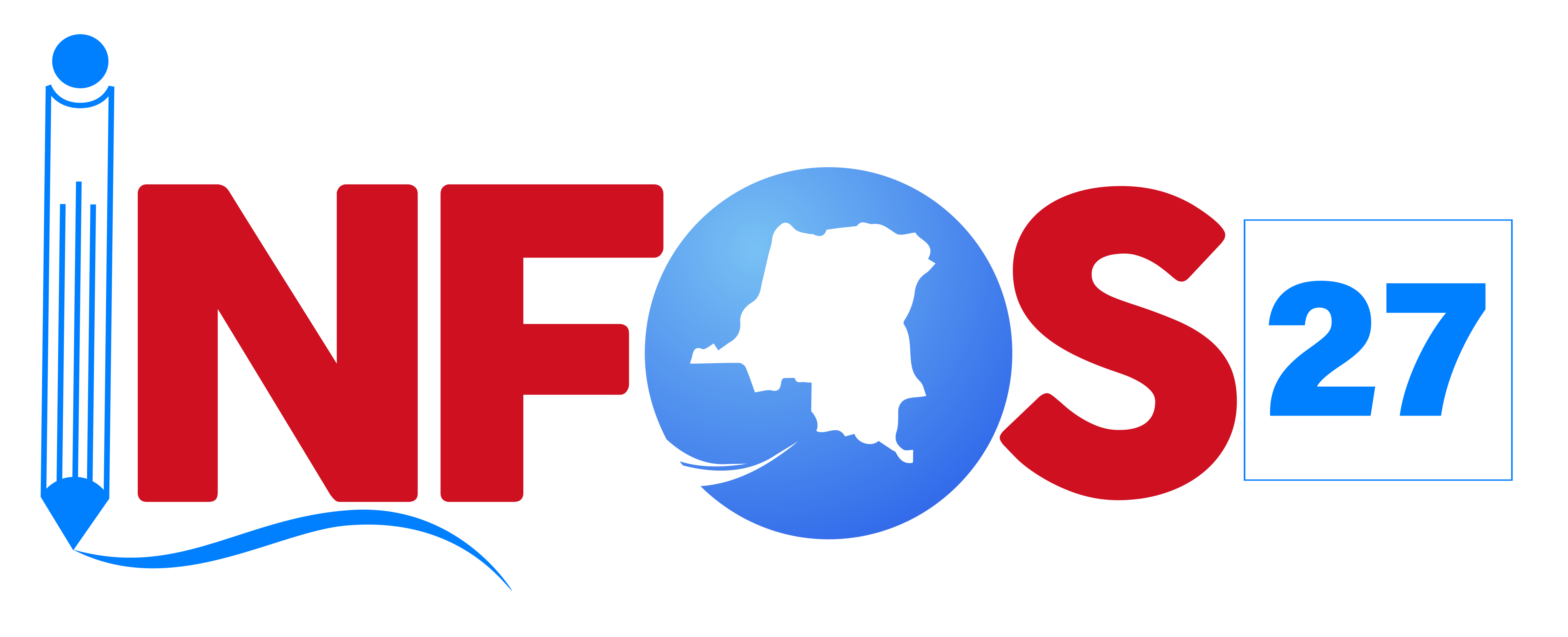Depuis plus de deux décennies, la République Démocratique du Congo est le théâtre de conflits armés récurrents, alimentés par l’ingérence du Rwanda et ses objectifs naturels prédateurs sur les ressources congolaises. Derrière le paravent de groupes rebelles factices, Kigali orchestre une guerre d’agression qui perpétue massacres, déplacements massifs de populations et pillages systématiques. Face à cette situation, la RDC doit-elle encore céder aux injonctions internationales pour dialoguer avec des mouvements créés de toutes pièces par l’ennemi ? Ce texte analyse les enjeux d’un dialogue biaisé et plaide pour une réponse souveraine, ferme et pragmatique à cette guerre d’usure.
La République démocratique du Congo est victime de conflits armés répétés depuis 1996 jusqu’à nos jours, en raison de l’agression rwandaise. Ces conflits ont occasionné la violation systématique des droits de l’homme et du droit international humanitaire, à travers des tueries, des carnages, des atrocités, des traitements inhumains et dégradants, des déplacements massifs de population et des crimes internationaux.
En effet, les rapports des Nations Unies et des organisations internationales des droits humains ont démontré noir sur blanc l’implication du micro-État prédateur rwandais dans ces conflits.
Il saute donc aux yeux que la guerre à l’Est du Congo n’est pas congolo-congolaise, mais plutôt rwando-congolaise. C’est l’État rwandais qui est à la base de ces conflits armés dans le but de piller exclusivement les ressources naturelles.
Pour camoufler ses forfaits sur le territoire congolais, l’État rwandais et ses complices (sociétés multinationales, firmes, etc.) peaufinent des stratégies, notamment en se déguisant en groupes rebelles congolais (RCD, CNDP, M23, AFC).
Ainsi, il place à la tête de ces mouvements quelques Congolais ignorants et manipulés, enclins à demander le dialogue, avec pour finalité d’infiltrer les Rwandais dans l’armée congolaise et dans les institutions stratégiques de l’État afin de déstabiliser la RDC. À titre exemplatif, un sergent rwandais, Bosco Tangana, fut nommé général en RDC à la suite du dialogue à travers le brassage et le mixage. Les cas sont légion.
Peut-on encore continuer à dialoguer dans ces conditions ?
Bien qu’il soit un mode de règlement pacifique des conflits souvent préconisés, nous estimons que le dialogue doit tenir compte de la souveraineté d’un État. Il ne doit pas être une occasion de l’aliéner.
L’histoire politique congolaise révèle que l’expérience malheureuse des dialogues ayant eu lieu avec les mouvements rebelles (RCD, CNDP, M23, AFC), créés par l’État rwandais, avait un dénominateur commun : partage du pouvoir, infiltrations, impunité (amnistie) et, enfin, rebondissements de la guerre d’agression.
Il n’est secret pour personne que le M23 n’existe pas en réalité. Il est une coquille vide montée de toutes pièces par l’État rwandais pour déstabiliser l’État congolais.
S’il doit y avoir dialogue, celui-ci doit intervenir entre l’État congolais et l’État rwandais, car c’est le président Paul Kagame qui est à l’origine de ces conflits armés. Il est le fondateur du M23/AFC et des autres mouvements politico-militaires (RCD, CNDP).
Dialoguer avec le M23, c’est rendre la guerre interminable. Cela conduira à la triste réalité selon laquelle « avant le dialogue égal après le dialogue ».
Ce serait un replâtrage et non un dialogue, car la raison avancée par l’État rwandais sur la prétendue discrimination de la communauté Banyamulenge est fausse et ne reflète pas la vérité. Les Banyamulenge résident paisiblement en République Démocratique du Congo. Les Congolais n’ont pas la culture de la discrimination des communautés.
Quant à la négociation avec l’État rwandais, elle n’est qu’un dialogue en trompe-l’œil. Lors de l’arrivée de l’AFDL, l’armée rwandaise avait pris le contrôle, pendant plusieurs années, du territoire occupé par l’AFDL à l’Est de la RDC sans jamais neutraliser les FDLR.
En outre, depuis 2022 jusqu’à nos jours, l’armée rwandaise occupe Nyiragongo, Masisi, Rutshuru et actuellement Goma, sans parvenir à neutraliser les moindres FDLR.
En réalité, l’argument des FDLR n’est qu’un prétexte cousu de fil blanc. La véritable raison, connue de tous, est le pillage des minéraux congolais, car la RDC est considérée comme une vache à lait et un État de libre-service.
Le micro-État prédateur rwandais ne doit pas imposer les conditions du dialogue pour négocier avec le M23/AFC. Dans ce cas, le recours à l’option militaire s’impose.
La RDC ne doit pas se plier à la pression de la communauté internationale l’amenant à dialoguer avec le M23. Elle ne doit en aucun cas accepter ce dialogue, car cette guerre dure depuis des décennies justement à cause des dialogues avec ces mouvements rebelles créés par l’État rwandais.
Ce dialogue conduit à un cercle vicieux et porte atteinte à la souveraineté nationale.
Plutôt que d’imposer à la RDC un dialogue avec le M23, supplétif du Rwanda, les Nations Unies sont invitées à appliquer le droit pénal international.
Elles doivent éviter de jouer un double jeu. Leur abstention à sanctionner l’État agresseur rwandais est coupable. Il en est de même pour leur refus de saisir la Cour Pénale Internationale afin de perpétuer les auteurs des crimes internationaux commis en RDC. Ce silence des Nations Unies est condamnable, car il empêche les multiples victimes de cette barbarie d’obtenir justice et réparation.
Nous concluons cette réflexion en manifestant notre soutien au processus de Luanda, qui vise le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, plutôt qu’au processus de Nairobi.
Nous encourageons cette initiative, car elle a pour vocation la restauration de la paix à l’Est. Toutefois, la République Démocratique du Congo doit rester vigilante, car les convoitises étrangères sur ses ressources naturelles remontent à la colonisation.
La voie vers une paix durable repose sur les actions suivantes :
Une armée professionnelle, républicaine, citoyenne et dissuasive.
La mise en place d’une industrie militaire (fabrication d’armes, de munitions, etc.).
Le renforcement de la diplomatie militaire et l’adhésion de la RDC à l’Alliance des États du Sahel, qui ne se limite pas aux considérations géographiques.
Le recrutement de cent mille militaires par an pendant dix ans.
La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques afin de garantir un budget conséquent pour atteindre ces objectifs, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens.
Un réseau diplomatique viable et efficace.
Des services de renseignement mieux équipés et fiables.
Une justice réellement indépendante et dissuasive.
La RDC a besoin de paix sociale. Trop de sang a coulé. Il est temps que justice soit rendue.
Bettens Ntumba